Histoire de la découverte et de l’achat de Chanin
ou
le long chemin pour reprendre un chalet d’alpage .

- 1. Les débuts
- 2. Opinel, ou la confirmation
- 3. La découverte de Chanin
- 4. Tractations
- 5. le chalet de la Saussaz
- 6. Acheter Chanin
- 7. Les préparatifs de la reconstruction
7a. Le matériel
7b. Le bois
7c. Le transport
7d. La main d’oeuvre et le cantonnement
7e. Le chemin - 8. La reconstruction
8a. L’héliportage
8b. Le démontage
8c. La reconception d’un chalet disparu
8d. Débuts de reconstruction
8e. La charpente
8f. La cave
8g. La couverture en bardeaux
8h. La couverture en lauzes - Contact
1. Les débuts.
Depuis février 1964, nous allions à chaque vacances d’hiver dans le petit village d’Albiez le Vieux, au lieu dit du » Mollard « . A Pâques, la neige » transformée « , c’est-à-dire fondue en surface par le soleil de l’après-midi puis regelée la nuit permettait de se promener facilement et sans danger d’avalanches dans toute la montagne, hors des pistes.
Ces conditions particulières étaient l’occasion de fréquentes » ballades » guidées par » Pierrot « , le fidèle moniteur, ce que les deux aînés ont pratiqué intensément autour des âges de 10 ou 12 ans, allant même jusqu’au sommet du mont Emy en montant droit dans les rochers en 1968. Mais sans faire des tours aussi importants, souvent et à tout âge, il y avait des excursions dans les alpages enneigés, faisant entrer en nous la beauté de ces paysages, des maisons isolées dans la montagne et de toute l’ambiance très particulière qui s’y rattache. Un de nos buts favoris de ballade, et un des premiers que nous nous sommes aventurés à faire sans guide, était de rendre visite à ce que nous appelions les » chalets jumeaux « . Il s’agissait de 2 petits greniers accolés, seuls et bien visibles sur la Praz. Comme ils étaient le but de cette promenade, nous étions curieux de les admirer de près, ainsi qu’une ruine de chalet qui était sur le trajet. 
Autour de ces années a été construit le téléski des » Aplanes » qui permettait d’aller plus haut que le seul téléski qui existait alors, il passait contre un groupe de deux chalets qui portait ce même nom. L’un appartenait à une famille de riches propriétaires des lieux et des remonte-pentes. Il avait été rénové et aménagé pour accueillir des groupes de colonies de vacances. L’autre était curieusement construit en travers de la pente et avait gardé son cachet de maison ancienne.
C’est ce chalet qui nous a fait rêver en premier. Notre père nous laissait imaginer que nous pourrions le posséder, nous faisions en imagination des projets sur ce que nous en ferions, et nous l’avions baptisé du nom d' » Aplans » pour le distinguer de l’autre.
Comme il n’était plus utilisé depuis quelques années déjà, même l’été, nous avons cru qu’il pourrait être à vendre. Après enquête dans le pays, le propriétaire se révéla en être un certain habitant de la Cochette, hameau de la même commune, mais plus bas et à 5 ou 6 kilomètres de là où nous habitions.
La décision fut prise, nous irions demander à ce propriétaire s’il consentirait à nous vendre son chalet. Nous partîmes en expédition à la Cochette dans une grande excitation. Mais la réponse fut claire: non.
La déception fut grande, mais le virus du chalet d’alpage n’était pas mort pour autant, au contraire.
2. Opinel, ou la confirmation
En 1972, nous allâmes à Albiez l’été pour la première fois. Très vite nous prîmes goût aux promenades dans la montagne, à aider au ramassage des foins et à rencontrer tout ce peuple montagnard que l’on ne voit pas vraiment vivre pendant l’hiver.
Un jour que nous étions occupés à je ne sais quoi, peut-être les foins comme tous les jours, nos parents étaient partis se promener sur ce qui restera toute leur vie leur promenade favorite: » la route de la Praz « , chemin de terre carrossable menant au bout du plateau sur lequel se trouvent les principaux alpages d’Albiez. Mais ce jour-là, ils eurent le courage de poursuivre au delà de l’extrémité de cette route pour suivre un sentier muletier, traverser un torrent, remonter une pente en lacets dans des arcosses, et aboutir sur une jolie prairie au sommet d’une croupe sur laquelle se trouvaient quelques chalets dont le principal encore recouvert de chaume était occupé par deux vielles femmes. Celles-ci portaient le nom d’Opinel et louaient ce chalet comme alpage depuis déjà quelques années et pour la dernière fois à une famille qui habitait maintenant Saint Jean de Maurienne.
Nos parents furent éblouis par ces chalets, par le site, par la vue sur les Aiguilles d’Arves, sur l’isolement de ce lieu, par le pittoresque des occupantes, et revinrent enthousiastes nous raconter leur découverte, notre rêve avait repris une forme encore plus séduisante.
L’endroit s’appelait » Pré-Naret « , mais nous l’appelions » le chalet Opinel » à cause de ses dernières habitantes. Comme précédemment » les Aplans » il fut le support de rêves incessants, nous pensions comment nous l’aménagerions, comment nous retracerons le chemin, avec ce passage toujours éboulé avant le torrent, et les arcosses qui envahissaient progressivement le chemin en lacet etc…
Pendant trois ans, les séjours à « Opinel » furent innombrables. Nous y allions bien sûr l’été, et à partir de 1974 nous disposions de vélos, et aussi d’une petite tente de montagne achetée par notre père, et nous purent alors même y passer la nuit et mieux explorer les environs.
Et puis l’hiver, à Pâques les skis permettaient d’aller visiter notre chalet de rêve. Il reste en particulier le souvenir marquant de Pâques 75 où nous avions décidé de passer la nuit là-haut avec nos cousins Bernard et Célie Cabane, montés le soir dans une neige désagréable et avalancheuse, un bon feu nous avait réchauffé près du chalet, puis l’installation pour la nuit pour laquelle Marc et Louis furent à la Belle Etoile, ne disposant que de deux tentes de deux places. Réveil au milieu de la nuit par des interpellations: » Ouvrez Police « : Une équipe de secours venait à la recherche de randonneurs disparus depuis deux jours derrière la Basse de Gerbier, et le feu vu du village avait fait croire que nous étions ceux-là. L’invraisemblance de cette conclusion par la distance qui nous séparait du lieu présumé des randonneurs en difficulté avait dû être surmontée par le plaisir des sauveteurs bénévoles de se faire une bonne virée entre copains et peut-être de toucher des dédommagements… Toujours est-il que cette randonnée nous fut injustement reprochée et nous laissa à la fois le souvenir d’une aventure rare, et une certaine amertume.
Cette nuit-là, l’équipe de secours se trouvant sur place inutile à 4 heures du matin résolut de passer la nuit sur place. Ils forcèrent donc le chalet en enfonçant le volet fermant une petite fenêtre. Ils firent du feu qui les enfuma rapidement faute d’avoir débouché le tuyau de cheminée, burent et s’endormirent là. Ce fut pour nous la seule fois où nous vîmes l’intérieur du chalet. Le lendemain un hélicoptère vint rechercher nos » sauveteurs » qui faute de s’être rendus utiles s’étaient bien amusés.
Pendant ce temps des tractations avaient été entreprises pour contacter les propriétaires, par l’intermédiaire du gardien de l’immeuble de nos parents: M. Jullien. Celui-ci nous dit qu’ils ne voulaient pas vendre, mais notre intermédiaire nous assura que cela pouvait changer, où même signifier le contraire. La réponse n’était donc pas positive, mais elle ne nous empêchait pas d’espérer, et donc nos rêves de continuer.
Mais en montant à Opinel un été 75 nous eûmes la surprise de voir que le chalet avait été refait, consolidé, une plaque de bois clouée sur la porte nous rappelait que nous n’y serions jamais chez nous: » Pré Naret, chez les z’Eustaches « . C’était fini, ils ne le vendraient plus.
Ce deuxième rêve prenait fin.
Or à peu près au même moment, le premier de nos rêves mourait une seconde fois par le fait que pendant l’hiver 74, une avalanche due à des travaux d’aménagements des pistes au sommet des Aplanes avait par son souffle totalement rasé le chalet des » Aplans « . Nous étions quelque peu rassurés alors de ne l’avoir pas acheté en son temps, mais c’était pour nous encore un deuil.
Les étés 75 et 76 nous ont alors vu arpenter la montagne pour voir s’il existait un chalet d’alpage capable de nous plaire. Mais le chalet que nous appelions « Chaix » au-dessus d’Opinel manquait de caractère, il ne comportait pas qu’une étable sans pièce d’habitation, et son univers pollué par un important bruit de torrent, les autres n’avaient pas de vue, ou trop près d’une route… Rien.
Et puis, au mois d’août 76, quelque chose se passe.
3. La découverte de Chanin
Notre soeur Anne-Catherine,  observant depuis le village le paysage et la montagne, remarque sur une crête relativement éloignée, sous la cime des Torches, un chalet tout seul, semblant régner sur une grosse croupe d’herbe le soutenant comme un présentoir au milieu des vallées environnantes.
observant depuis le village le paysage et la montagne, remarque sur une crête relativement éloignée, sous la cime des Torches, un chalet tout seul, semblant régner sur une grosse croupe d’herbe le soutenant comme un présentoir au milieu des vallées environnantes.
La lecture de la carte apprit qu’il s’agissait du chalet de Chanin à 2200m d’altitude, et qu’il avait très probablement une vue exceptionnelle.
Une expédition fut vite montée pour aller visiter ce chalet mystérieux. Le mot « expédition » n’est pas trop fort, en effet, les parents étaient déjà repartis avec la voiture à Paris, il fallut dont aller à pieds au village d’Entraigues dans la commune de Saint Jean d’Arves à 7 kilomètres du Mollard, et de là entamer les plus de 1000 mètres de dénivellation jusqu’au chalet. Le chemin à suivre était relativement évident sur la carte, mais sur le terrain ce n’était pas très simple. D’Entraigues, il fut décidé de rejoindre le Besset du dessous, puis de couper à travers prés vers le chemin horizontal du Monzart. (Il n’y a en effet pas de chemin direct depuis Entraigues puisque Chanin était atteint depuis la Villette). Le chemin ensuite se suivait bien avec sa charmante traversée suspendue jusqu’aux Ramées, son impressionnant passage au-dessus du torrent du Vallon, puis l’interminable montée du autre côté, les agréables lacets dans le Motey, délicatement ombragé par des arbres isolés qui fut baptisé alors de » paradis « , puis une difficile traversée dans des arcosses, et enfin un chemin tellement embroussaillé qu’il fut décidé de rejoindre la crête de Chanin au dessus de l’Arcosse pour monter droit hors sentier vers le Chalet.
Cinq heures après le départ, l’arrivée au Chalet fut un éblouissement. Suspendu en pleine montagne, le chalet en assez bon état offrait une vue splendide et unique sur toutes les Alpes, allant depuis les Aiguilles d’Arves bien détachées, jusque devant lui s’étendant vers le Mont Blanc à près de 100 km de là. Le Chalet, sur un petit replat agréable était charmant, un simple fil de fer maintenant la porte fermée permis d’en visiter l’intérieur qui était sobre et rustique mais encore tout plein de témoignages de la vie des alpages. Une toute petite fenêtre carrée donnait sur cette vue couronnée par le Mont-Blanc. Un chemin partant horizontalement permettait d’atteindre une source merveilleuse de fraîcheur et au goût unique. Tout cela, mêlé à l’ambiance unique d’un alpage de haute altitude, et à la satisfaction d’arriver après une longue randonnée fit que ce chalet apparut immédiatement comme étant le plus beau chalet que l’on n’ait jamais pu voir. Il avait la plus belle vue, le meilleur emplacement, il était le plus isolé, le plus haut, il était en bon état, et puis, sans que l’on puisse dire pourquoi, une sympathie immédiate s’établit, comme un coup de foudre.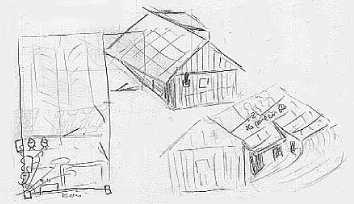
Le lendemain, une lettre m’était envoyée alors que j’étais en séjour à New-York pour raconter en détail cette découverte extraordinaire, et depuis ce jour, ce chalet auquel on n’avait jamais fait attention fut une évidence dans le paysage, tant on le voyait bien, seul sur sa crête et tant on le voyait de partout.
Après la rentrée à Paris, Chanin fut le sujet de bon nombre de discussions, on en parlait, on essayait de m’expliquer à moi qui n’avais pas eu la chance de le voir à quoi il ressemblait et de me faire vivre une partie de l’émotion de la découverte. Cela fut si bien fait qu’une autre expédition fut décidée pour la Toussaint, afin que je puisse me rendre compte moi-même.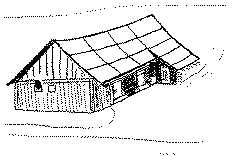
C’est ainsi qu’arriva le 1er novembre 1976. Les deux frères aînés avaient décidé de monter à Chanin coûte que coûte, et d’y passer la nuit. Le temps n’était pas au beau. Mais qu’importe, à Albiez, c’était supportable. C’était sans compter la différence d’altitude et l’aggravation qui devait survenir…
Nous avions décidé de partir à vélo pour éviter de la fatigue jusqu’à Entraigues. Ceux-ci furent donc enchaînés dans un buisson au-dessus du torrent à la sortie d’Entraigues, et nous partîmes sur le même chemin que celui emprunté quelques mois auparavant pour la première découverte.
Il faisait gris, le chemin était glissant et difficile, mais la montée se fit néanmoins sans trop de difficulté. L’arrivée au chalet fut comme toujours une grande joie, mais ce jour-là, point de vue, de la neige qui commençait à tomber, un froid intense et un blizza rd transperçant toutes nos épaisseurs.
rd transperçant toutes nos épaisseurs.
A trois heures de l’après-midi, nous pénétrâmes dans le Chalet, dont la porte était d’ailleurs grande ouverte, par suite sans doute d’un acte de malveillance…
Mais cette cuisine de Chanin, si séduisante dans sa rusticité l’été, était devenue fort peu accueillante. Un courant d’air important la traversait de part en part, aggravé par le fait que le pignon du mur de pierre côté est était tombé. L’été cela ne gênait pas, mais là… Bien enfermés dans cet abris précaire, non bûmes un chocolat chaud, nous visitâmes le chalet, nous fîmes l’inventaire de ce qui s’y trouvait, de la vaisselle contenue dans la table, et il n’était guère plus que trois heures et demi ou quatre heures. Que faire alors pour attendre jusqu’à la nuit? Nous n’avions rien à faire et il faisait de plus en plus mauvais, venteux et froid.
Alors nous décidâmes de redescendre. Nous en avions assez vu. Trois photos furent prises du chalet, un billet fut laissé sur la table pour remercier le propriétaire de l’abri et l’avertir que la porte avait été ouverte et que nous l’avions fermée, nous rembarquâmes nos duvets, notre réchaud à gaz et en route par le même chemin. La neige tombait alors à gros flocons. Une quatrième photo fut prise dans les lacets du Motey puis, mouillés et frigorifiés, ce fut l’enfer d’un chemin rendu extrêmement glissant par la neige sur lequel nous tombions sans arrêt. Un paysan fut rencontré sur le chemin vers les Ramées, il venait d’aller fermer les portes de ses chalets au Vallon, et il nous vit partir plus souvent sur les fesses que sur nos jambes à travers pré pour rejoindre le Besset du dessous. 
Les vélos retrouvés vers 6h du soir, il n’y avait plus qu’à remonter à Albiez. Mais nous avions pris de vieux vélos lourds et avec les sacs, après nous être laissés glissé jusqu’à Belleville, c’est en poussant les vélos qu’épuisés nous entreprîmes les 5 kilomètres qui nous séparaient de la maison, un petit poste de radio fixé sur le porte bagage nous distrayant un peu de notre effort. A chaque bruit de moteur, nous espérions qu’une camionnette pourrait nous prendre avec nos vélos… mais pas un mètre de route nous fut épargné.
L’expédition fut dure, mais une certitude était maintenant incontournable, Chanin était un chalet unique et merveilleux, c’était lui qu’il nous fallait. Mais cette fois, nous fûmes lâchés par nos parents, qui trouvaient ce chalet trop loin, trop inaccessible, et puis pas dans leur pays. Aussi, ce n’est que le 4 septembre 1977 que nous sommes allés demander à la mairie le nom du propriétaire de ce chalet. Il n’a pas été nécessaire à l’employé municipal de consulter le cadastre, il nous a immédiatement dit qui était le propriétaire. Son nom était bien connu à Saint Jean d’Arves. Mais à quoi bon aller le voir puisque nous n’avons aucune possibilité financière de l’acheter ?
4. Tractations
Au cours de l’été 1978, le problème de financement s’engage mieux puisque Marc entrant dans une école de fonctionnaire (l’IGN), il recevra un salaire. Aussi le 5 septembre 1978 nous sommes allés au Villard à la maison du propriétaire. Nous sommes reçus par sa mère, qui est tout à fait favorable à notre projet. Malheureusement ce n’est pas elle seule qui est propriétaire, mais ses 5 enfants depuis le partage au décès de son mari. Mais encourageante, elle nous dit qu’elle va en parler à son fils…
Au début de l’été suivant, Louis, Anne-Catherine et Étienne sont seuls à Albiez (les parents sont à  Paris, Marc est en stage en Dordogne). Après 2 jours d’entraînement intensifs, les 3 courageux engagent à la sueurs de leurs muscles de plusieurs trajets pour reprendre les tractations. D’abord un aller et retour pour reconnaître l’état de Chanin (un peu plus usé, mais encore en bon état), puis 2 tentatives pour finalement aller à vélo voir le propriétaire, qui les reçut dehors, pour lui demander s’il voulait vendre son chalet. La réponse fut plutôt négative, mais surtout très évasive. » Je ne sais pas, il faut demander à la famille « : 5 frères et soeurs disséminés dans toute la France. » On en parlera, repassez plus tard « . Ce n’était pas très encourageant, mais tout espoir était permis, on pouvait donc se mettre à rêver, et nous ne nous en privâmes pas.
Paris, Marc est en stage en Dordogne). Après 2 jours d’entraînement intensifs, les 3 courageux engagent à la sueurs de leurs muscles de plusieurs trajets pour reprendre les tractations. D’abord un aller et retour pour reconnaître l’état de Chanin (un peu plus usé, mais encore en bon état), puis 2 tentatives pour finalement aller à vélo voir le propriétaire, qui les reçut dehors, pour lui demander s’il voulait vendre son chalet. La réponse fut plutôt négative, mais surtout très évasive. » Je ne sais pas, il faut demander à la famille « : 5 frères et soeurs disséminés dans toute la France. » On en parlera, repassez plus tard « . Ce n’était pas très encourageant, mais tout espoir était permis, on pouvait donc se mettre à rêver, et nous ne nous en privâmes pas.
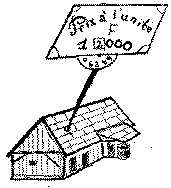
La famille des propriétaires va se consulter et réfléchir pendant tout l’été. Le 29 septembre 1979, Louis descend de Paris pour aller reprendre la Land Rover beige qui était en réparation, il en profite pour aller voir le propriétaire. L’espoir se précise, La famille des propriétaires est d’accord pour vendre mais demande que nous fassions une offre. La difficulté est qu’il n’y a pas de marché du chalet perdu et le prix pourrait être n’importe quoi, et le propriétaire refuse absolument de donner la moindre indication de ce qui lui semblerait normal. Nous tînmes conseil entre nous, et nous envoyons une lettre offrant 5 000 francs. Faute de réponse, et faute d’avoir un téléphone pour l’appeler, nous organisâmes d’aller passer le week-end des 13-14 octobre là-bas pour connaître sa réponse. Par mesure d’économie, nous prîmes un train de nuit en place assise, bien que fatigués, nous passâmes une jolie journée d’automne à la montagne, mais le propriétaire nous dit que pour cette somme il ne fallait même pas y compter, que divisée en 5 il n’en restait pratiquement rien, et qu’il n’en était donc pas question. La déception fut grande, notre offre trop basse a tout arrêté. Une nouvelle proposition de 13 000 f par lettre ne permettra pas de relancer les négociations.
 Malheureusement, pour ce chalet et pour ce qu’il représente comme témoignage de la vie rurale d’autrefois, ses propriétaires préféraient alors voir leur chalet se dégrader doucement que de le céder à un prix peu élevé à des amoureux qui en prendraient soin. Les années suivantes nous virent régulièrement monter à Chanin pour le plaisir, et faire des visites régulières au propriétaire à vélo pour lui demander si il avait enfin pu prendre une décision en contactant ses frères et soeurs. Comme d’habitude, il nous recevait dehors mais amicalement, et nous discutions là d’abord quelque temps avec la grand mère, lui et ses deux soeurs, leur faisant parler de la vie des alpages, avant de reposer la question fatidique dont la réponse était toujours reportée à plus tard. En fait, la grand-mère était favorable à l’idée de nous le vendre pour qu’il ne tombe pas en ruine, mais le propriétaire gardait l’idée vague et idéaliste de remonter là-haut, au moins pour la chasse (ce qu’il ne fera jamais).
Malheureusement, pour ce chalet et pour ce qu’il représente comme témoignage de la vie rurale d’autrefois, ses propriétaires préféraient alors voir leur chalet se dégrader doucement que de le céder à un prix peu élevé à des amoureux qui en prendraient soin. Les années suivantes nous virent régulièrement monter à Chanin pour le plaisir, et faire des visites régulières au propriétaire à vélo pour lui demander si il avait enfin pu prendre une décision en contactant ses frères et soeurs. Comme d’habitude, il nous recevait dehors mais amicalement, et nous discutions là d’abord quelque temps avec la grand mère, lui et ses deux soeurs, leur faisant parler de la vie des alpages, avant de reposer la question fatidique dont la réponse était toujours reportée à plus tard. En fait, la grand-mère était favorable à l’idée de nous le vendre pour qu’il ne tombe pas en ruine, mais le propriétaire gardait l’idée vague et idéaliste de remonter là-haut, au moins pour la chasse (ce qu’il ne fera jamais).
Il faut dire en effet que le Chalet commençait à se dégrader sérieusement. Aux alentours de 77, des tôles furent arrachées sur le faîte du toit, ce qui permit à la neige et à la pluie de tomber dans la grange, de mouiller le foin qui y restait, ayant pour effet de le pourrir avec les planches qui le supportaient pour finalement, quelques années plus tard s’effondrer en cassant deux entraits de la charpente. Très rapidement donc, on ne put plus entrer dans la cuisine, et encore moins dans l’écurie puisque tout l’étage du dessus était passé en dessous. 
Et puis un été, en 1982, nous découvrîmes que la porte de la grange avait été arrachée, probablement par un coup de vent, celui-ci s’engouffrant dans le trou du toit, et provoquant une surpression à l’intérieur de la grange. D’autres tôles ont continué à partir, on pouvait les voir en montant à Chanin, réparties le long du chemin, jusqu’à plus de 100m en dénivelées en dessous du chalet.
Dés ce moment, le chalet était en danger de mort, ces ouvertures permettant au vent particulièrement violent l’hiver sur cette crête de s’engouffrer dans le chalet, et de le gonfler comme une montgolfière.
Et ce qui devait arriver arriva.
En montant avec un groupe de scouts à la Toussaint 1985 l’horreur inévitable se révéla avoir eu lieu: le vent avait pris le toit, l’avait déplacé de deux mètres latéralement vers l’Est, et d’un mètre vers le sud, pour le laisser retomber à cheval sur le mur de pierre, brisant tout les entraits restant, démolissant une partie du mur, et l’arrière du toit tombant à l’intérieur du chalet. Vu d’en bas, on ne voyait pas grand-chose, parce que le triangle du toit demeurait bien visible, tout au plus était-il abaissé d’un mètre, et déplacé hors de ses murs, mais sur place, les dégâts apparaissaient évidemment comme considérables.
De ce jour, nous montâmes moins souvent à Chanin, la peine de voir ce chalet blessé et agonisant étant trop forte. Nous avons continué de demander au propriétaire s’il ne voulait toujours pas céder son chalet, espérant que cet accident le déciderait, mais il n’était toujours pas décidé. Il ne se rendait pas compte vraiment des dégâts, ceux-ci ne se voyant pas tellement du bas, disait qu’il remonterait là-haut pour le réparer, que c’était l’histoire d’une semaine, ou qu’il réutiliserait les matériaux pour faire un petit abri pour chasseurs dans le fond de ce qui restait de la maison. Quelle horreur.
A cela s’ajouta une crise de suspicion, trouvant notre insistance louche, nous disant: « pourquoi vous voulez l’acheter? » à notre réponse que c’était pour le plaisir, il émetait des doutes. Il lui était en effet difficile de comprendre cette engoument. Il faut dire que pour lui, ce chalet était pour lui plus un outil de travail particulièrement pénible qu’un objet de loisir, il supposait qu’il devait y avoir une autre raison de notre acharnement. Il supposait peut-être quelque chose en rapport avec la chasse, ou bien une oeuvre de promoteur quelconque… Le dialogue devenait de plus en plus difficile, c’était désespérant.
Alors nous sommes revenus à l’idée qu’il pouvait y avoir d’autres chalets intéressants dans la montagne. Un nous a séduit, qui comportait aussi un bon nombre de critères d’exception: le chalet de la Saussaz.
5. le chalet de la Saussaz
Ce chalet était très extraordinaire en effet. Notre attention avait dû être attirée sur lui à cause du récit du célèbre alpiniste Whymper qui raconte comment venant du col des aiguilles d’Arves, il fait étape dans ce chalet avant de repartir au petit matin par Martignare pour la brèche de la Meije. Nous avions déjà aperçu ce chalet, pour la première fois durant l’été 77 en montant au col de Martignare, le voyant de haut en arrivant au sommet de » la tranchée « . 
Le chalet de la Saussaz se trouvait à 2000 mètres d’altitude, au pied des Aiguilles d’Arves, cela devant être compris dans le sens le plus littéral possible. En effet, de ce chalet il fallait lever la tête pour voir presque à la verticale les aiguilles énormes, d’une présence irréelle et obsédante. Pour le reste, il n’y avait pas de vue, que les Aiguilles, et puis une atmosphère d’alpage de bout du monde avec ses torrents, son herbe rase, les rochers, les éboulis, avec en face les pentes montant aux cols Lombard et Martignare.
La Saussaz n’avait en fait de commun avec Chanin que son isolement, toujours impossible d’y aller en voiture, et quel que soit le point de départ, mille mètres de dénivelée. En fait, sa situation était même plus complexe, ce qui contribuait à lui donner du charme. En effet, en partant d’Entraigues, il fallait remonter tout le cours extraordinaire de Val Froide, puis monter des lacets dans la forêt, traverser trois combes fort dangereuses, on était alors non loin du chalet, et à la même altitude, mais une dernière combe infranchissable obligeait de monter encore 200m en zigzags pour redescendre sur le chalet. De l’autre côté, on pouvait partir du bout de la route d’alpage de Montrond, monter 500m jusqu’à la Basse de Gerbier, puis redescendre 500m de l’autre côté. Cela faisait la moitié, mais il fallait remonter les 500m au retour…
De Chanin, on est loin du monde, mais on voit le monde. Avec des jumelles, on peut voir des centaines de villages, des routes, des lumières etc… de la Saussaz, on ne voit rien, personne, et aucune trace de civilisation. Ce que l’on voyait de la Saussaz en 1985 ne devait pas avoir changé du moindre détail de ce que pouvait voir Whymper un siècle auparavant, le temps s’y était arrêté. Pas un bruit, pas une lumière de la civilisation ne pouvait y parvenir, on s’y trouvait vraiment comme dans un autre monde. 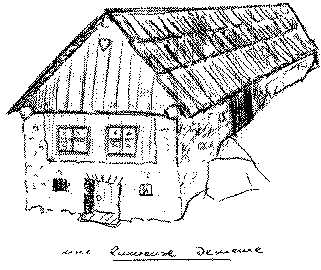
Et puis, autant Chanin est une maison relativement rudimentaire, autant la construction de la Saussaz était extraordinaire pour un chalet d’alpage. Il était d’une dimension considérable, et était même, dit-on le seul chalet dans toute la région à avoir trois étages en façade. Pour trouver un autre chalet sur le même plan, il fallait aller au-dessus de Saint-Sorlin d’Arves, dans la vallée du Col des Prés nouveaux. Construit sur une pente, on accédait comme dans tous les chalets de plein pied dans la grange (en fait là trois ou quatre marches), mais devant, deux étages plus bas, s’ouvrait l’écurie, et au-dessus, une cuisine gigantesque, en plancher ouvrant sur les Aiguilles par deux fenêtres, garnie d’un mobilier étonnamment raffiné pour un chalet d’altitude, avec derrière, au lieu de l’emplacement habituel de l’écurie, des locaux annexes pour mettre les brebis, les chèvres, une cave, et une fromagerie. Pour couronner le tout: une subtilité: une grosse canalisation en planches de 80 cm de côté traversait la cuisine verticalement pour envoyer directement le foin de la grange à l’écurie.
Déjà attirés par ce chalet, j’avais été avec Etienne passer une nuit dans ce chalet, alors que nous en avions déjà visité d’autres un peu partout sans grande conviction (sauf un peu pour l’Alpettaz, au dessus de Saint-Sorlin, mais avec une vue insuffisante).
Ce fut à la Toussaint 1983. Les journées étant courtes à cette saison il avait été décidé que nous trouverions le moyen de passer la nuit dans le chalet. Après un passage de la Basse de Gerbier dans une tempête épouvantable, c’est à la tombée du jour que nous approchâmes du chalet et dans une demi-pénombre, le toit nous sembla avoir une curieuse apparence. En nous approchant plus, nous découvrîmes que toute la partie arrière du chalet avait été refaite, et c’était les tôles neuves qui brillaient plus que les autres. Après la visite de la maison, nous nous installâmes pour une bonne nuit dans le foin de la grange. Nous eûmes l’explication plus tard: une partie du toit avait été emportée par le souffle d’une avalanche et avait été reconstruite avec l’aide d’un hélicoptère à la fin de l’été. Le lendemain, le temps était magnifique et nous rentrâmes en passant par les chalets du Col.
Après y avoir longuement réfléchi, ce chalet nous tenta fort, et nous décidâmes de mettre un plan d’action pour envisager d’acquérir cette maison extraordinaire.
Attendant la fin de l’hiver, j’organisai une expédition de reconnaissance, à la Pentecôte 1985 en compagnie de deux de mes éclaireurs. Le Week-end de trois jours fut bien utilisé. Voyage en T.G.V., location d’une voiture, courses, départ à pieds du relais de télévision. Le reste de la course fut éprouvant; enfonçant sans cesse dans une neige qui ne portait plus suffisamment, mais encore abondante, alors que les deux jeunes garçons marchaient sans peine grâce à leur faible poids supporté par la croûte, arrivée à la Basse de Gerbier de nouveau par une tempête épouvantable, redescente vers le Rieu Blanc, et installation du campement sur une plaque d’herbe. Le lendemain, un lever difficile, tout est froid et humide, les chaussures trempées, mais le chemin est repris en direction du chalet. Là, une surprise effroyable nous attendait, le chalet avait été complètement décapité, il ne restait rien du toit, la maison s’arrêtant net au sommet des murs de pierre. Le sort semblait s’acharner sur cette pauvre maison: l’année d’après avoir été refaite, une autre avalanche achevait la destruction qu’avait tentée la première. Mais les murs étaient encore en bon état, le dégât récent, et on pensait que c’était réparable. Une carte postale punaisée sur un mur nous donna l’adresse d’un certain Robert R. à Saint Jean d’Arves.
Le lendemain, avant de prendre le train, visite à R. qui nous dit n’avoir été qu’un locataire, mais il nous donne les coordonnées du vrai propriétaire: G. à Saint Jean de Maurienne. G. est plus tard joint par téléphone de Paris, mais voulant éviter un dialogue sans vrai contact, je vais à Saint Jean dans une journée pour le rencontrer dans un café. La réponse est peu positive, G. a une très haute idée de son chalet, et ne serait pas prêt à s’en séparer pour moins de 200 000 ou 400 000 francs… absurde et inabordable.
Mais l’idée de ce chalet unique qui était en train de devenir rapidement et irrémédiablement perdu nous taraudait, une lettre fut envoyée à G. proposant de réparer gratuitement le chalet même sans nous le vendre. Cette lettre est restée sans réponse. Le chalet de la Saussaz ne sera plus jamais admiré par personne.
(On s’est d’ailleurs demandé comment il s’est bien pu faire qu’un chalet qui durait depuis plusieurs siècles ait été détruit deux hivers de suite. Une première réponse possible est que les probabilités météorologiques sont telles qu’il se peut très bien qu’une chose très improbable survienne deux années de suite. Mais l’explication la plus plausible est la suivante. Ce n’est pas une avalanche à proprement parler qui a détruit le chalet, mais le souffle provoqué par une avalanche à proximité. Or, autrefois, les chalets étaient couverts non de tôles légères, mais d’une importante masse de bois sous forme de bardeaux. Et d’autre part, les chalets étaient en général laissés l’hiver la grange pleine de foin. Tout cela contribuait à lester le toit, et à le remplir, empêchant le vent de s’y engouffrer. Il est donc évident qu’un chalet dont le toit est en tôles et vide est infiniment plus vulnérable qu’il ne l’a jamais été.)
Restait Chanin, qui pourrissait lentement sur place auquel nous ne montions plus guère. Nous étions encore passé voir le propriétaire une fois ou l’autre, mais même sans lui parler du chalet, ou simplement pour lui dire qu’il se détruisait. Des chasseurs avaient récupéré des planches pour faire à l’intérieur de la ruine un petit abri plein de courants d’air, la végétation poussait à l’intérieur sur un matelas de foin et de bois pourris qui devenait de la terre…
Nous parlions de notre passion au passé, il valait mieux ne plus y penser, ça avait été un rêve d’enfants, impossible à réaliser.
6. Acheter Chanin
A la Toussaint 1990 J’emmenai quelques éclaireurs d’Evreux dans le chalet du Mottet, et je parlais de Chanin, du propriétaire, et de sa soeur . Les jeunes voulurent les rencontrer aussi. Et c’est ainsi, que je revins voir le propriétaire le 2 novembre 1990 alors que cela faisait plus d’un an qu’on n’était plus venu le voir. On parla un peu de Chanin, et il ne lui fut rien demandé à ce sujet. Ce fut lui qui dit enfin d’une voix presque inaudible: « pour Chanin, vous seriez toujours acquéreurs?, parce que avec la famille finalement, on serait prêts à le vendre « . Je n’en revenais pas, nous n’y pensions plus du tout, mais comme c’était un vieux rêve d’enfance, j’ai dit sans y penser: « bien oui, je crois, enfin faut voir… « . Cette fois, je n’ai pas voulu tomber dans le piège de proposer moi-même un prix alors je lui ai demandé son idée, et il m’a dit: » et bien je crois que 10 000 chacun, ça fait 50 000 et c’est bien « 
Cette proposition nous prit de court. Le Chalet était maintenant dans un état lamentable, tout était tombé, tout pourrissait, et il était évident qu’à ce prix d’achat devrait s’ajouter des frais considérables pour remonter la maison, pour peu même que cela soit possible. Mais nous l’avions trop désiré, nous en avions trop rêvé pour laisser passer cette occasion que nous avions tant attendue, pendant près de 15 ans, il n’était donc pas question de refuser.
J’y suis retourné à Noël pour un week-end, c’était d’accord, le propriétaire allait descendre voir le notaire un de ces jours pour faire préparer les papiers.
Mais « un de ces jours » pour le propriétaire pouvait prendre assez longtemps, et ce notaire à Saint Jean de Maurienne est réputé pour sa lenteur et sa mollesse. Or il fallait obtenir la signature de tous les frères et soeurs de l’indivision, sans qu’aucun ne change d’avis, aussi n’osions-nous vraiment espérer arriver à quoi que ce soit un jour.
Mais il arriva un jour où le notaire que nous passions régulièrement voir pour essayer de le faire avancer un peu, nous montra un papier signé de tous les membres de la famille des propriétaires: une promesse de vente. Nous n’en revenions pas. Mais ce n’était pas fini, il fallait encore que cela passe dans le journal officiel pour la SAFER afin que si quelqu’un voulait acheter ce terrain à des fins agricoles, il puisse le faire. Nous n’avions guère de craintes à ce sujet puisque le propriétaire nous avait avoué qu’il avait proposé à tout le pays de mettre ses terres de Chanin à disposition gratuitement pour qui voudrait et que tous lui avaient fait gentiment remarquer que ces alpages étaient beaucoup trop loin… Mais enfin, on ne sait jamais.
Tout cela a si bien traîné que l’été 1991 arriva et que nous n’étions toujours pas propriétaires de Chanin.
Mais ce temps ne fut pas perdu, et je le mis à profit pour monter au chalet et faire un relevé le plus précis possible de la maison, avec la dimension de tous les bois, et une estimation de ce qui pouvait être réutilisé.
Je commis en fait plusieurs erreurs dans ce relevé, d’abord par excès d’optimisme sur la nature des bois qui se révélèrent bien plus pourris que je ne le pensais, et ensuite sur le fait que j’imaginai que le chalet était parallélépipèdique, toutes les fermes étant semblables, alors que c’était loin d’être le cas. Mais à partir de là nous avons pu cogiter tout l’hiver pour préparer la reconstruction, envisager les dépenses, les matériaux dont nous aurions besoin et quelles méthodes utiliser.
Au printemps 92, rien de définitif n’était encore signé, nous ne pouvions être sûrs de rien. Il fallait absolument pouvoir le réparer l’été suivant sans perdre encore une année. Le siège du notaire fut dressé, après avoir fait celui du propriétaire pendant toutes ces années, nous étions préparés. Il reçu un coup de fil ou deux par semaine, pour le pousser à engager chacune des opérations nécessaires. Il y avait en particulier le petit risque que la SAFER fasse valoir son droit de préemption sur les terres agricoles. Et puis juste avant l’été, le notaire nous dit que enfin l’acte de vente avait été signé et que tout était en ordre. Nous n’osions y croire. Notre soulagement était d’ailleurs d’autant plus fondé que le notaire nous dit alors qu’au moment de signer l’acte de vente, un des membres de la famille ne voulait plus le faire. C’est lui qui a du les menacer en disant qu’ils s’étaient engagés par la promesse de vente et qu’ils risquaient un procès de notre part. Nous n’en serions sans doute jamais venus là, la réalisation de notre rêve et le chalet de Chanin a échappé belle.
Nous étions ainsi propriétaires du chalet de Chanin, avec les 25 hectares de terres qui l’entouraient, il ne restait plus qu’à mettre en oeuvre une énergie formidable pour remettre dans son état d’origine un chalet que plus de 15 ans de tergiversations avaient rendu inaccessible par le développement des arcosses bloquant tous les chemins d’accès, et transformé en une ruine, faite de pierres tombées et d’un tas de bois pourris à plus de trois heures à pieds de l’accès automobile le plus proche.
7. Les préparatifs de la reconstruction.
Dès la promesse de vente signée, et l’évaluation d’août 91 faite sur place, nous avions bon espoir sur le fait que nous pourrions être un jour vraiment propriétaires de Chanin, et il fallait donc envisager comment nous nous y prendrions pour le reconstruire.
Ce qui nous semblait alors la principale difficulté était que la charpente n’était plus au dessus du chalet, mais s’était décalée de deux mètres vers l’est et d’un vers l’avant, tombant à l’intérieur de la maison. A ce moment là, je pensais que la majorité des bois étaient réutilisables et qu’il suffisait de remplacer les entraits cassés plus quelques chevrons. Nous avons donc envisagé d’essayer de déplacer l’ensemble de la charpente pour la remettre en place. Cela supposait de la soulever pour la remettre au niveau du mur du fond, puis de la déplacer sans rien faire écrouler. Longtemps nous sommes restés sur cette idée, mais en fait, nous n’avions pas une idée très précise du poids que pouvait représenter une telle charpente. Quant au déplacement, il nous sembla de plus en plus hasardeux puisqu’il fallait à la fois soulever, maintenir la charpente en équilibre sur des piliers, puis la déplacer sans qu’elle retombe.
Finalement, par le conseil d’un professionnel nous a convaincu que le plus simple était de démonter la charpente, et de la remonter en place. L’avenir donnera raison à cette méthode, en particulier parce que la charpente était pourrie ou cassée à plus de 50%.
Avant de pouvoir intervenir directement sur le chalet, il restait néanmoins de nombreuses choses à faire. Il fallait: des outils, des tentes, un poêle à bois, des matériaux (en majeure partie du bois), de la main d’oeuvre, un chemin praticable, envisager le transport et puis penser à tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Tout ce qui ne serait pas transporté dès le début par hélicoptère devrait être par la suite porté sur le dos.
Nous nous sommes mis d’accord sur le principe de base de notre travail : l’authenticité primait absolument, en particulier sur le confort. Une étude fut engagée pour définir selon ce principe ce que nous voulions faire. La première source de données était la somme d’indices et de mesures relevés à Chanin par Louis, complétés par une visite éclair pour éclaircir un ou deux points mystérieux. Cela permit de dresser des plans détaillés, et de décider ce que nous comptions garder de l’ancien et ce que nous devions remplacer à l’identique.
Nous avons cherché par ailleurs tout ce que nous pouvions comme renseignements auprès de la famille qui possédait le chalet auparavant, et des anciens du pays. le propriétaire ne se souvient pas de grand chose, sa mère et sa soeur un peu plus, mais chaque renseignement sur Chanin était précieux pour le restaurer. Une chance fut de rencontrer Joseph B., du village de la Saussaz qui, lui, avait bonne mémoire de la vie et des techniques de construction dans les alpages de son temps et, chose extraordinaire, même du temps de ses parents.
Nous sommes allés à la bibliothèque des Compagnons, où nous avons trouvé des éléments techniques intéressants. Les livres nous ont également donné des renseignements sur l’architecture locale et sur les techniques de base (charpente, maçonnerie). Louis trouva aussi chez son coiffeur une numéro de » Maisons & Travaux » qui parlait des toitures en bardeaux, il eut la permission d’emporter ce numéro intéressant et qui donnait une petite bibliographie qui nous a permis d’aller plus loin dans notre formation.
Des travaux de reconstructions aussi importants supposent en théorie de déposer un permis de construire à la Mairie, en temps utile. Nous avons donc retiré les imprimés nécessaires, et nous nous sommes renseignés sur la manière dont est instruite une telle demande. Cela prend du temps, nous a-t-on répondu, le mieux est d’aller voir la DDE, c’est elle qui décide d’accorder le permis ou non. Nous avons donc établi de jolis plans, et nous sommes allés voir le responsable avec notre série de photos montrant Chanin du temps où il était en bon état, et une photo actuelle sous un angle où il avait un aspect pas trop délabré (et non une des photos où on voit bien qu’il faut tout refaire). Le » responsable » chargé de l’urbanisme n’y connaissait visiblement pas grand chose en architecture rurale locale, il ne savait pas que les bardeaux était un des modes de couverture traditionnelle à cet endroit, et il a répondu que nous devions faire une demande et qu’on verrait. Un peu dépités nous sommes alors allés voir le maire de Saint Jean d’Arves qui nous a dit de faire les travaux que nous avions prévus, que c’était formidable, lui-même étant fort amoureux également des chalets d’alpage. Nous avons été bien soulagés, et nous avons enterré notre demande de permis de construire, en décidant de prendre le risque de tout faire sans rien dire. Mais dans le fond, nous ne voulions rien modifier de son aspect original, et donc il ne devait pas y avoir de problème.
7a. Le matériel
Pour les outils, cela a été assez simple, après réflexion et de nombreuses listes, nous sommes allés chez « Grange « , le quincaillier de Saint Jean de Maurienne et nous avons acheté une pleine Land-Rover d’outils en tout genre: pelles, truelles, marteaux, clous, niveaux, scies, tronçonneuse, pinces pour couper les arcosses, mèches, ciseaux à bois, mètres roulants, sceaux etc… Au cours de ces achats de matériel, nous tentions de palier notre inexpérience par la réflexion et en questionnant nos indicateurs. Cela nous sauva en bien des points, en particulier en pensant à la charpente, et en voyant la tête des gros clous de 25 cm que notre livre de charpente nous conseillait d’acheter, nous demandons incidemment au quincaillier: » et pour planter ça, il ne faudrait pas un gros marteau, par hasard ? » Bien sûr nous dit-il, sinon c’est impossible ». Du coup nous avons acheté un très gros marteau Stanley de 2,5kg. De même pour retirer les clous, nous avions le choix entre une demi douzaine d’outils divers, à l’intuition, nous achetons 1 petit arrache-clous, et 2 énormes pinces-monseigneur de cambrioleur-chef. Là encore, ce fut déterminant. Sans ces outils, jamais nous n’aurions pu démonter la toiture rouillée et gonflée d’eau.
Le luxe de l’achat d’une tronçonneuse fut décidé, là aussi un peu au hasard, malgré nos hésitations devant le danger que représente cette machine quand on est si loin du premier hôpital. Mais finalement cela nous économisera des semaines de travail dans la construction de Chanin et se révélera bien utile par la suite pour dégager d’anciens chemins.
Au dernier moment, à une semaine du transport par hélicoptère, nous nous rendons compte que nous avons complètement oublié de prévoir une échelle. Or si Chanin n’est pas bien haut, le pignon nord est quand même à 6 m du sol, et pour démonter puis reconstruire toute la toiture, il nous en fallait évidemment au moins une. On cherche un peu, et finalement, en en parlant autour de nous,, deux personnes nous proposent de vielles échelles en bois qui ne leur servent plus. Nous avons la bonne surprise en découvrant celle que nous allons chercher à Albiez-le-Jeune: elle est tout à fait dans le style du pays, et de plus, grande et solide.
Il nous fallait aussi une claie de transport, pour monter du matériel à pieds, transporter des pierres, et surtout aller chercher l’eau à la source avec des jerricans. Le Vieux Campeur nous a fourni un modèle parfaitement résistant et qui s’est révélé indispensable.
Nous avions pensé aussi qu’il fallait bien avoir un abris le temps que le chalet soit démonté et remonté. Pour cela, nous avions envisagé de dormir sous une tente de patrouille (j’en avais une), de mettre nos sacs sous une autre plus vieille (récupérée à l’Oratoire), et d’utiliser une vieille tente de camping familial qui avait été donnée à Marc pour servir de QG aux éclaireurs, afin de servir de cuisine. Mais comme les environs de Chanin offraient peu d’endroits vraiment plats, nous envisageâmes de mettre la grande tente de « VP » (« Visages Pâles », c’est ainsi que les scouts désignent les touristes) sur un petit emplacement à peu près plat tout contre le chalet, et de monter les deux tentes de dortoir sur le grand replat où passe le chemin, 30 mètres en dénivelée plus bas. Cet endroit fut baptisé ironiquement par Étienne: « le camping des mouettes « .

Le poêle à bois était une nécessité absolue. Il fallait bien une source de chaleur pour que la vie soit supportable là haut. Nous savions qu’il en fallait un pour le chalet, et ceux d’origine étaient totalement inutilisables, détruits par la rouille. Or, première difficulté, un petit poêle en fonte à 4 feux, comme il y en a normalement dans tout chalet d’alpage, c’est un objet qui est maintenant introuvable. La plupart ont maintenant près de 80 ans et sont percés par la rouille, et ceux qui en possèdent encore un en bon état n’ont absolument pas envie de s’en défaire. Nous avons eu beau chercher dans le pays, personne ne pouvait nous en fournir un dans un état correct. Une dizaine de coups de téléphone à tous les ferrailleurs de la vallée nous a finalement convaincus que cette recherche d’un poêle d’occasion ne nous offrirait qu’un poêle en très mauvais état. Mais un de ces ferrailleurs nous donna un renseignement précieux, il avait vu par hasard dans une vitrine à Modane un poêle en fonte, en tout semblable aux anciens, mais neuf. Nous sommes allés à Modane pendant les vacances de Pâques, et nous avons ramené un joli poêle en fonte, à 4 feux absolument comme ceux d’origine, mais tout neuf. La chance nous avait une fois de plus favorisé, ainsi que l’honnêteté de ce ferrailleur qui n’avait aucun intérêt, bien sûr, à nous orienter vers du matériel neuf.
En effet, nous pensions, qu’il serait bien agréable d’avoir un poêle, même pendant la reconstruction, et nous pensâmes que nous pourrions l’installer dans la grande tente de cuisine. Nous savions qu’il pouvait faire » frais » dans la montagne. Or nous savions que de mettre un poêle dans une tente, bien que semblant curieux, se faisait par les trappeurs canadiens, et avait été fait par Partridge dans les premiers temps du » campisme « . Cette idée fit bien plus que d’apporter de l’agrément, elle conditionna la réussite de l’entreprise. Sans source de chaleur, nous aurions sans doute dû abandonner, tant la rudesse du climat dépassait notre imagination. Nous ne savions pas que nous aurions pendant les 15 premiers jours de juillet du froid, de la glace, de la neige, du vent, de la grêle etc… et que le poêle était une simple condition de survie.
Le poêle tout beau tout neuf fut engrangé avec le reste dans le garage de Faë-Fronn, l’immeuble où nos parents ont un appartement.
Nous envisagions la possibilité d’avoir une radio permettant d’appeler du secours en cas d’accident grave. Aussi de multiples contacts et renseignements furent pris pour trouver une solution possible. Mais aucune solution satisfaisante n’a alors été trouvée. Les réseaux de téléphones portables ne couvraient pas cette zones, la distance avec Albiez était assez grandes, les réglementations étaient impossibles à respecter, le matériel était très cher… En désespoir de cause nous avons été obligé de prendre le risque de n’avoir aucun moyen d’appeler du secours autre que la cabine téléphonique qui se trouvait à Entraigues, à 1 h en se dépêchant au maximum. Cela convenait pour une morsure de vipère, pour un accident mineur sur une personne qui ne serait pas seule, mais il ne fallait absolument pas d’accident avec la tronçonneuse, ni en manipulant les lourdes poutres de la charpente,…
7b. Le bois
Pour le bois, c’était beaucoup plus compliqué, il fallait calculer finement ce dont nous avions besoin, en pensant à la qualité du bois, l’épaisseur, la longueur. etc… Les fournisseurs possibles étaient nombreux, mais nous avions, comme d’habitude des exigences assez spéciales et il était difficile de les faire comprendre.
La principale difficulté vint du fait que nous voulions recouvrir le chalet comme il était à l’origine avec des bardeaux. Nous savions en effet que la couverture en tôle sur les chalets ne datait que des environs de la guerre de 14, et qu’avant, ils étaient recouverts de bardeaux, c’est à dire de planches de sapin ou de mélèze mises dans le sens de la plus grande pente, chaque planche possédant une rainure en forme de rigole à un centimètre de chaque bord. Cette couverture était même une originalité de la région de Saint Jean d’Arves, puisque c’est le mode de couverture utilisé normalement dans les Hautes Alpes, de l’autre côté de la crête. dans la vallée de la Maurienne, c’était habituellement les » Tavaillons « , petites tuiles de bois recouvrant le toit comme des écailles. Notre enquête dans le pays fut très décevante. La plupart des habitants actuels n’avaient gardé aucun souvenir de ces bardeaux, ou pensaient tout simplement que c’était impossible. Or nous avions pu voir sur des chalets à l’abandon depuis longtemps des vestiges de ces bardeaux qui avaient en fin de compte plutôt mieux résisté que les tôles plus récentes. Et nous avons trouvé finalement en insistant quelques rares anciens se souvenant seulement que ces toits avaient la particularité de toujours goutter à l’intérieur de la maison. Or, en faisant les relevés précis de la charpente de Chanin l’été 91, j’eus la très heureuse surprise de voir que la majorité des liteaux utilisés pour soutenir les tôles étaient en fait des planches réutilisées, et qu’elles avaient pour la plupart une rainure de chaque côté! Nous avions là la preuve que Chanin avait été recouvert ainsi avant les tôles.
Il n’en fallait pas plus pour nous décider de retrouver ce mode original de couverture. Personne n’étant capable de nous dire comment cela se faisait dans notre vallée, le Conseil Général de Savoie se désintéressant de l’architecture rurale nous a renvoyé sur son homologue des Hautes Alpes, qui, plus conscient de la valeur de leurs traditions et de leur patrimoine, a pu nous envoyer un important dossier sur la question, ainsi que les coordonnées d’un professionnel. Cet artisan spécialiste a ainsi bien voulu nous expliquer très gentiment comment il fallait s’y prendre pour disposer ces planches, en tenant compte de la rétractation, ou de la dilatation qui pouvait avoir lieu en fonction de l’humidité des planches.
Il nous fut confirmé que les bardeaux mis simplement n’étaient jamais totalement étanches, il suffit d’un noeud mal placé entre deux autres planches pour qu’une gouttière survienne malencontreusement. Pour éviter cela plusieurs méthodes sont utilisées, et nous avons finalement opté pour une solution simple: mettre une couche de feutre bitumineux entre les deux épaisseurs de planches. Cela avait l’avantage de laisser respirer chacune des couches de bois, et d’être pratiquement invisible tant de l’intérieur que de l’extérieur.
Quant à l’appentis servant de cave à Chanin, nos recherches nous ont appris qu’il devait être recouvert de grosses lauzes retenues par des fils de fer. Nous avons en effet retrouvé quelques unes de ces grosses pierres pesant près de 10 kilos et munies de deux petits trous à une extrémité. La pente faible du toit à cet endroit ne permettait que ce mode de couverture. Mais pour le reconstituer, il aurait fallu trouver une bonne centaine de ces lauzes, mais faute de savoir où aller les chercher, nous avons mis ce projet à plus tard, et décidé de récupérer les tôles utilisables pour laisser provisoirement la cave couverte de tôles. Aujourd’hui encore, ce travail demeure en suspens. La technique consiste à prendre une pierre de schiste bien plate de taille suffisante, et de les détailler en tranches de 3 à 5 cm avec un burin, puis de les percer délicatement ! Cela suppose d’abord d’apprendre à faire ce délicat travail, et de trouver assez de pierres convenables. Les ressources locales ne semble pas suffisantes (nous les connaissons assez bien après avoir ramené des environs des centaines de grosses pierres pour la reconstruction de Chanin) le seul endroit possible pour aller les chercher semble être la base de la cime des torches. Mais une personne ne pourrait guère en ramener plus de trois ou quatre par jour…
Concernant les bardeaux, nous avons fait volontairement une entorse à l’authenticité: Chanin avait été couvert de bardeaux d’épicéa, mais alors que ceux-ci ont une durée de vie de l’ordre de 50 ou 60 ans (rappelons qu’aucun bois n’est traité), on trouve encore dans certaines régions de bardeaux de mélèze qui sont encore en bon état après plusieurs siècles. Le mélèze a en effet la réputation d’être pratiquement imputrescible. Neuf son aspect est assez différent, puisqu’il est rouge alors que l’épicéa est jaune clair, mais en vieillissant, les deux deviennent gris argenté de la même manière. Or, on trouve encore dans la vallée des Arves des mélèzes par endroits. On peut donc penser qu’il y en avait de bien plus nombreux autrefois et qu’une utilisation excessive les a fait progressivement disparaître. L’utilisation du mélèze pour le toit de Chanin était donc un luxe certes, mais pas une absurdité.
Il fallait cependant trouver une scierie qui veuille bien nous fournir plusieurs mètres cubes de planches de mélèze et les rainurer une à une de la manière voulue, bien que cela lui semble absurde!
Et ce n’était pas la seule exigence bizarre que nous avions. Nous voulions aussi que les poutres ne soient pas carrées, mais laissent apparaître l’arrondi du tronc sur chaque angle, pour garder l’aspect des poutres anciennes qui étaient équarries à la main. Or ce travail nous sembla trop difficile et important à réaliser nous-mêmes, nous voulions donc que la scierie trouve des troncs du diamètre correspondant exactement et fasse quatre faces plates, en laissant à chaque fois le « flache » pour utiliser le terme technique. C’était encore un travail de précision que beaucoup ne voulurent pas faire. Notre objectif était avant tout esthétique, mais à l’usage, ces poutres vont avoir l’avantage d’être parfaitement centrées sur le coeur du bois, ce qui n’est en général pas le cas si la poutre a été taillée dans un tronc d’arbre plus gros.
Enfin nous désirions des chevrons non équarris, simplement des têtes de sapin, comme ceux d’origine. En général, les scieries ne s’encombrent pas de ce qu’ils considèrent comme des chutes, qui sont simplement abandonnées en forêt. Mais par chance, ils en avaient une pile dans un coin, qui avaient été rapportés pour servir à autre chose, mais finalement non utilisées.
Parmi toutes les scieries des environs, une seule a bien voulu nous faire ce travail: celle de Villard-Gondrand. Une liste précise, d’une longueur considérable et d’une infinie complication fut établie par Marc de ce que nous voulions et donnée à l’artisan afin qu’il réalise notre commande pour le 25 juin, cela devait représenter plus de 10 tonnes de bois.
Sur ce point eut lieu un second miracle. Après une conversation avec un charpentier local rencontré par hasard, nous décidons de remonter à Chanin pour vérifier plus précisément l’état de chacun des poutres de la charpente. Le truc est de donner un coup de hache dedans pour voir si le bois a conservé sa solidité en profondeur, et pas seulement un aspect sympathique. Le temps pressait: il ne restait qu’une semaine avant la livraison du bois, et la venue de hélicoptère. L’examen recommandé s’est avéré important: les deux sablières sont endommagées sur la moitié de leur longueur, et 3 des arbalétriers sont irrécupérables (sur 10). Vite un coup de téléphone depuis Entraigues, au bas du chemin de Chanin pour commander ce complément. Malheureusement, dans la précipitation, les poutres prévues pour les arbalétriers vont être commandées avec la même section que les sablières, c’est à dire avec 3 cm trop. À l’occasion de ce contact, la scierie nous dit qu’elle nous conseille de prendre plus de chevrons, que ces vieux bouts de bois les encombrent et que cela nous sera toujours utile pour mettre dans le poêle si nous n’en avons pas besoin. Sans bien savoir pourquoi, nous avons accepté en se disant peut-être que cela pourrait bien servir… Nous pensions n’en avoir besoin que d’une petite dizaine. Il nous en fut livré même plus que prévu: au moins trente. Et le démontage du chalet nous fit découvrir que les trois quarts des chevrons anciens étaient pourris et inutilisables. Nous n’aurions jamais pu reconstruire le chalet sans tous ces chevrons providentiels…
Les choses commençaient à se préciser, mais il fallait aussi prévoir comment nous ferions monter tout cela sur place.
7c. Le transport
S’il n’y avait eu qu’une ou deux poutres à monter, on aurait pu envisager de le faire à pieds, les anciens faisaient bien ainsi, mais ils disposaient de plus de temps que nous, de plus de main d’oeuvre, et de nombreux mulets. La seule solution était donc: l’hélicoptère. Là aussi il fallut étudier finement pour savoir si nous aurions les moyens de nous offrir ce luxe. Envisager la charge à transporter, évaluer le nombre de rotations en fonction de la puissance de l’appareil, temps nécessaire à chacune etc… Il fallait enfin trouver un lieu où nous pourrions livrer le matériel par camion, et où l’hélicoptère viendrait le chercher. Il nous avait été dit qu’il fallait une dizaine de minutes à un hélicoptère pour s’élever de 1000m, mais que le déplacement horizontal était somme toute assez rapide. Il fallait donc trouver une aire de chargement la plus élevée possible. Nous pensâmes d’abord au terrain de l’altiport qui se trouve à 1750m d’altitude juste derrière la crête du Châtel. Une piste de terre y conduit depuis les Chambons. Il n’était pas certain que le camion puisse y monter, mais nous avions pensé que nous aurions pu faire des navettes avec la Land Rover. (Nous n’avions à ce moment là pas d’idée précise de la masse énorme de ce que nous avions à transporter!) Une reconnaissance fut faite à Pâques, le temps était à la pluie, le terrain gras. Nous n’avions pas quitté la piste gravillonnée du Poingt de plus de 10 mètres que la voiture se mit à patiner, à glisser sur le côté et se retrouva plantée dans un fossé. Plus d’une heure de lutte acharnée sous la pluie fut nécessaire pour sortir la voiture. Nous étions trempés, couverts de boue. Il fallait visiblement chercher un autre lieu de chargement.
Notre seconde idée fut le plateau de Montrond. D’un accès assuré, il est assez loin de Chanin (environs 6 ou 7 kilomètres), mais se trouve à une altitude de 1950m, et puis nous avons sur place le chalet du Mottet de notre ami Martin qui nous est toujours ouvert. L’expérience nous apprit plus tard, que l’idée, sans être mauvaise n’était pas la meilleure. En effet, la distance horizontale était tout de même importante, et l’hélicoptère chargé de planches plus ou moins instables ou même à vide avec une élingue qui pend, risquant de remonter se prendre dans le rotor arrière, ne peut pas aller très vite.
La décision prise, il fallait fixer un lieu précis en trouver le propriétaire et obtenir son accord. L’endroit idéal fut trouvé, la recherche entreprise, de bons contacts avec de nombreuses personnes de Montrond, mais le propriétaire jamais trouvé. Alors tant pis, on fera comme ça!
Une date fut fixée pour le transport héliporté: mardi 30 juin au matin. Un gros camion affrété pour aller chercher les 13 tonnes de bois dans la vallée et les livrer sur le plateau la veille, et une petite camionnette pour livrer au même moment tout ce que nous aurions accumulé dans le garage d’Albiez.
7d. La main d’oeuvre et le cantonnement
Il restait encore la main d’oeuvre à trouver et à organiser notre séjour à Chanin pendant la reconstruction.
Pour cela, nous en parlâmes largement autour de nous, dans la paroisse, auprès de nos anciens Eclaireurs etc… Quelques volontaires se proposèrent: un ancien EU de Versailles et un copain, un jeune d’Evreux pour juillet, et en août, où Marc serait seul: Sophie Lemarchand et deux anciens routiers de l’Oratoire, cela pouvait aller. 2 ou 3 autres volontaires annoncés nous ont finalement fait faux bond.
Pour la nourriture, nous avions prévu de faire en gros des menus sur une semaine: le matin petit-déjeûner avec beaucoup de lait en poudre et un peu de lait UHT chocolat, café, pain et confiture, le midi des salades, à base de taboulé, ou piques niques, et le soir un repas plus consistant. C’est la viande du soir qui posait en fait le plus gros problème, ne disposant pas à Chanin de bon moyen de conservation. Notre idée fut alors de prévoir les menus pour une semaine, avec ravitaillement hebdomadaire par deux volontaires pour tout le monde. Le premier jour on disposerait ainsi de viande fraîche, le second de viande un peu moins fraîche, le troisième de charcuterie, le quatrième de saucisses emballées sous vide, le cinquième d’oeufs, et des boîtes pour terminer la semaine.
Il fallait alors prévoir tout ce dont nous aurions besoin pour un mois et demi et qui soit conservable, Marc devait l’acheter dans un super marché en allant à Albiez fin juin, en même temps que quatre malles métalliques pour les stocker à l’abris de l’humidité et des rongeurs, afin de profiter de l’hélicoptère pour le monter. Cela augmentait considérablement le prix de journée, puisque le prix du portage devait être à peu près de 3 francs par kilos, mais c’était la seule façon pour éviter que nous passions notre temps à faire des courses.
Cette organisation se révéla parfaitement au point, et heureusement que nous n’avions pas toute la nourriture à monter du bas à pieds, car chaque course à Saint Jean nous voyait remonter avec régulièrement, en plus de la nourriture 10 à 20 kilos de matériel divers: clous, liquide vermifuge, tronçonneuse à faire réviser, tuyaux de poêle, outils, etc…
7e. Le chemin
La dernière chose à préparer avant d’envisager de réparer Chanin était de remettre le chemin en état. Celui-ci n’avait en effet plus été entretenu depuis 1962 qui est la dernière année où quelqu’un a séjourné à Chanin. Or en 30 ans, la nature avait repris ses droits et monter à Chanin était devenu une chose extrêmement pénible et fort difficilement envisageable avec un sac de 30 kilos sur le dos comme cela devait devenir notre habitude.
La première partie du chemin jusqu’au torrent du Vallon était restée tout à fait correcte, parce que encore fréquentée par certains troupeaux. Dans la remontée de l’autre côté dans le grand Zig et Zag, le sol était encore bien marqué, mais il fallait progresser en fonçant dans un rideau permanent de feuilles, de branches et de buissons. Cela faisait qu’on ne pouvait voir ses pieds, qu’il fallait sans cesse se baisser, et que l’on était très rapidement trempé par l’eau de pluie ou de rosée qui se déposait alors évidemment sur nous. Les voûtes du Motey étaient à peu près suivables, mais il fallait sans cesse sortir du chemin pour contourner un buisson d’arcosse qui avait trouvé bon de pousser au milieu. C’est ensuite que les principales difficultés commençaient. La Grande traversée dans les Arcosses était devenue absolument impossible à suivre avec un sac (alors qu’elle était encore praticable en 76), et les lacets qui suivent sous Chanin étaient complètement bloqués par des buissons denses impénétrables, et cela depuis longtemps, nous n’avions jamais pu suivre cette partie du chemin, il fallait alors rejoindre la crête pour monter droit dans l’herbe. Cela faisait que nous avions pris l’habitude de ne plus passer par là, mais de monter par la côte de Coirnavan et de rejoindre Chanin par la source. A cet endroit, les arcosses avaient grandi moins vite, et bien que péniblement, on arrivait quand même à monter. Mais en 91, même ce chemin était devenu impraticable, il fallait sans cesse couper à travers pente, se frayer son chemin au milieu d’arcosses serrés, et tout cela gaspillait une énergie considérable.
Si l’on voulait travailler à Chanin, il fallait disposer d’un chemin à peu près praticable.
Pour cela, nous achetâmes une « goyarde « , gros croissant en acier qui se révéla peu utilisable à cause de la souplesse des arcosses, et une pince coupante à démultiplication qui se révéla de la plus grande efficacité. Une première mission fut faite à Pâques et permit de dégager une partie du ZigZag, mais il restait trop de neige pour aller plus loin, ou même de faire bien le travail. Cela nous permit de nous rendre compte de l’efficacité de la pince, et qu’il fallait prévoir beaucoup de temps pour le chemin. Aussi, de retour à Paris achetions-nous une autre pince coupante encore plus grosse permettant de couper sans effort un tronc de 7 à 8cm de diamètre, et programmai-je de passer 3 ou 4 jours sur le chemin début juin.
La première journée, sous une pluie continue se fit avec l’aide de notre père. L’un coupait, et l’autre dégageait. Nous travaillâmes sans discontinuer 6 heures, et à la fin, sans être parfaits, le Zig Zag étaient fréquentables, et la grande traversée d’Arcosses permettait enfin le passage.
La seconde journée, j’allai tout seul. Les premières voûtes, après la traversée me désespérèrent: au lieu des gros arcosses que l’on rencontrait précédemment, c’était de petits buissons appelés là bas « vordets » pour lesquels il fallait donner 20 ou 30 coups de pince pour les faire disparaître. J’ai travaillé toute la journée avec une énergie farouche. D’autant que j’avais la crainte de n’avoir pas le temps de terminer le chemin, auquel cas mon travail aurait été inutile, n’ayant créé qu’un cul de sac. Aussi faisai-je le travail au minimum: juste la largeur suffisante pour passer, et s’il y avait de l’herbe dégagée longeant le chemin, et bien on passerait par là, et tant pis pour les arcosses qui s’étaient installées dans le creux du chemin. Un rapide pique nique après 4 heures de travail, et l’obsession de la destruction des arcosses me reprenait, la pluie devenant de plus insistante, et mon béret totalement trempé, c’est abrité par un vieux parapluie me reposant sur la tête que je continuai. Parfois, les arcosses étaient tellement nombreux et denses que des doutes se trouvaient sur le tracé du chemin. J’avançais ainsi mètre par mètre, créant le chemin devant moi. A un moment donné, j’arrivai à un talus abrupt me démontrant que je m’étais trompé. Je dus revenir en arrière d’une quinzaine de mètres pour retrouver le chemin que j’avais perdu. Ainsi, lacet après lacet, le chemin continuait. Je laissai dans une boucle un petit bouleau solitaire au milieu de ces buissons inhospitaliers, deux voûtes plus haut, un courageux petit sapin d’un mètre de haut me salua sur ma gauche, je trouvai une tôle du toit, et ayant juste vaincu un buisson d’arcosses plus gros que les autres, j’eu la joie de voir le sommet du toit de Chanin, j’avais effectué la jonction avec la partie supérieure du chemin qui elle était en herbe et praticable.
Marc revint quelques jours avant le début des travaux, fin juin. Il retravailla encore sur le chemin, faucha les « chapeaux », (grosses feuilles de choux qui gardent perfidement toute l’eau de la rosée ou de la pluie pour vous mouiller vos chaussures), et enfin, le chemin, s’il n’était pas parfait, était praticable. Ce travail correspondait déjà à presque une semaine de travail. 
Il fallut en fait attendre l’année suivante pour que le tracé du chemin soit suivable tout du long, évitant le fait désagréable d’avoir à monter sur le talus du chemin pour éviter des buissons, et encore une année pour qu’il soit dégagé sur une largeur suffisante pour ne pas être trempé en montant.
Ce chemin demandera encore des heures et des heures de travail. Nous aurons au total certainement consacré plus d’heures au chemin qu’au chalet lui même. Il aura fallu près de 10 ans de travail pour parvenir à un chemin vraiment agréable et avoir retrouvé partout l’ancien chemin. Du coup maintenant de nombreux promeneurs viennent l’emprunter… Pourquoi pas, tant qu’ils respectent notre domaine…
Tout était donc prêt, il n’y avait plus qu’à se mettre au travail.
8. La reconstruction
8a. L’héliportage
Le lundi 22 juin, Marc partit avec son Trafic rempli de tout ce que nous avions réuni à Paris pour notre grand projet. Il y avait: des tentes en tout genre et des bâches, un tonneau en châtaignier de près d’un mètre de diamètre (Nous pensions que celui qui se trouvait devant la cave de Chanin, servant de citerne en recueillant l’eau du toit était pourri. En fait, il ne l’était pas, il se remit tout seul en service dès que le cheneau fut en place), des outils, des gamelles, des réchauds à gaz, etc…
Il avait pour mission d’acheter en route tout le ravitaillement à monter en hélicoptère, d’améliorer encore le chemin, d’acheter encore toute une liste d’outils et de matériaux divers, puis de faire en sorte que tout soit prêt pour la date de livraison du matériel au plateau de Montrond.
Quant à moi, ayant présidé un baptême le dimanche 28, je partis le soir par le train de nuit en compagnie d’Alexandre Dudouit, un jeune d’Evreux. Le lendemain matin, récupération de la Land Rover chez Martin, puis complément de courses de matériaux à Saint Jean de Maurienne.
En fait de complément, il s’agissait de plus d’une tonne se sable pour faire du mortier!
Les sacs furent chargés un à un. Jusqu’à 700 kilos, on s’inquiète pour la charge utile (prévue pour 450 kilos), mais ensuite, la carrosserie reposant sur les Silentblocs, il n’y avait plus rien à craindre de pire, et nous y allâmes de bon coeur. La montée par la route des Arves ne se fit il faut l’avouer pas à une vitesse très élevée, et c’est tanguant comme un vaisseau ivre que j’arrivai sur le plateau de Montrond où Marc était déjà présent. 
Peu de temps après, le camion de bois et la camionnette arrivèrent sur place. Pour celle-ci, ce ne fut pas trop dur, mais le plus gros dû tout de même chaîner pour passer un bourbier. Le camion fut arrêté dans le pré sur le bord du chemin, les deux conducteurs repartirent à bord de la camionnette, et il ne nous restait plus qu’à descendre les 13 tonnes de bois de la benne pour les mettre bien rangés sur l’herbe Une journée n’est pas de trop pour faire ce travail à trois.
Il fallait de plus tout mettre par paquets de 350 kilos, cela représente en effet la charge que peut prendre l’hélicoptère à chaque voyage, or celui-ci étant payé à l’heure, il fallait qu’il ne perde aucun temps à charger, et donc que les charges soient toutes prêtes.
Le soir, le transporteur vint reprendre son camion, et nous, nous allâmes prendre nos quartiers dans le chalet de Martin quelques cents mètres plus haut. Le temps était maussade, du brouillard s’accrochait aux montagnes. Il nous fallait absolument du beau temps le lendemain: sinon nous aurions du attendre ensuite que hélicoptère soit de nouveau disponible, et entre temps il nous aurait fallu monter à Chanin le minimum pour vivre et commencer les travaux…
L’hélicoptère devait arriver le lendemain à 7h. Tôt le matin pour profiter de l’air frais qui est plus porteur. A sept heures moins le quart nous étions en place, remettant un peu d’ordre dans notre étalage, essayant de calculer la masse de chaque tas en évaluant le volume et en multipliant par une densité présumée… Le temps était assez beau, effectivement nous eûmes une des seules journées correctes de cette semaine, la pluie ne revint qu’en fin d’après midi. A sept heures moins cinq, un bruit de pales, et l ‘hélicoptère jaillit tout soudain devant nous pour se poser sur une petite butte au dessus de nous.
‘hélicoptère jaillit tout soudain devant nous pour se poser sur une petite butte au dessus de nous.
A peu près au même moment arrivait le taxi apportant deux de nos jeunes venus par le train de nuit. L’un était un de mes anciens éclaireurs de Versailles: Cyril Palmade, et l’autre » un copain » dénommé Franck Simonnet. Le copain en question n’avait pas vraiment le physique de l’emploi, cheveux en banane, boucle d’oreille, paquet de cigarette dans la poche de la chemise, et sac valise pour porter ses affaires! Je demandai à Cyril s’il lui avait bien expliqué de quoi il s’agissait… mais il m’assura qu’il n’y avait pas de problème. De toute façon, c’était un peu tard pour se poser des questions, et puis nous avions vraiment besoin de main d’oeuvre. L’avenir devait nous prouver que l’habit ne fait pas le moine, et Franck se révéla un des meilleurs garçons du monde, courageux, serviable, habile, généreux et toujours positif.
L’hélicoptère partit alors reconnaître l’emplacement du chalet, avec à son bord Marc et un copilote qui devaient rester là bas pour réceptionner les charges.
Un troisième employé de la société d’héliportage aurait déjà dû être là, venu à bord d’une camionnette chargée d’une réserve de carburant. Mais il tardait, et un bruit de moteur inutile et énervé quelque part dans le plateau nous laissait deviner ce que nous allions apprendre une demi heure plus tard: il s’était enlisé dans la piste boueuse!
Il m’incomba donc d’établir la liaison avec l’appareil au moyen d’un talky walky, et d’accrocher les premières charges de bois au moyen de deux élingues au crochet de l’hélicoptère qui faisait du surplace quelques mètres au dessus de nous dans un vent qui tendait à vouloir détruire notre bel agencement.
Le talky permettait de communiquer avec le pilote. Il arrivait en effet que l’hélicoptère décolle, puis repose la charge brutalement parce que trop lourde, où au contraire, qu’après l’avoir soulevée, il se rende compte qu’il pourrait prendre 50 kilos de plus, ce qui n’était pas négligeable, pouvant permettre de réduire en fin de compte le nombre des rotations. 
Les objets divers étaient, eux, mis dans des filets, et les filets vides, comme les élingues revenaient pendues au crochet de l’hélicoptère, simplement lestés avec un gros caillou. C’est ce qui constitue un des risques majeurs de l’opération, car cette charge légère risque à tout moment d’aller se prendre dans le rotor arrière. Le Talky servait aussi aux collaborateurs d’inciter le pilote à la prudence, en rappelant que l’un d’eux était tombé la semaine précédente!
À Chanin, deux personnes désignaient à hélicoptère l’endroit où il devait déposer la charge, se précipitait dès qu’elle touchait le sol pour décrocher l’attache, puis faisait signe à l’hélicoptère qu’il pouvait repartir. Il fallait alors reconstituer bien à plat la pile de bois plus ou moins écroulée, et poser dessus des cailloux pour que le vent de l’hélicoptère, et le vent naturel fréquent en altitude ne vienne pas éparpiller nos précieux matériaux dans les ravins.
Les rotations ainsi se succédèrent toute la matinée, de plus en plus lourdes, à mesure que l’hélicoptère se vidait de son carburant. Une pose pour le déjeuner, un plein pour l’appareil et c’était reparti.
Lorsque l’hélicoptère revint pour prendre sa dernière charge, il la souleva, resta stationnaire quelques secondes et pilote annonça qu’il y avait au moins 50 kilos de trop! C’était rageant. A plus de mille francs la rotation, être obligé d’en faire une pour une si petite charge, cela mettait la boite de petit-pois au prix du caviar.
Mais le pilote était un ancien de l’armée, et dit qu’il allait quand même essayer de la prendre. Il s’éleva lentement, puis se mit en route vers Chanin. Quand il disparut derrière la crête qui nous masquait le chalet d’où nous étions, nous entendîmes sa voix dire aux autres: » j’arrive avec une charge un peu lourde, éloignez vous, je ne sais pas dans quelles conditions je parviendrai à la déposer! « . Il faut dire en effet que la charge limitait considérablement sa marge de manoeuvre et qu’il perdait toute finesse de pilotage. Il paraît que l’arrivée fut effectivement assez brutale, mais il n’y avait rien de précieux dans ce dernier chargement et tout était donc pour le mieux.
32 rotations avaient été nécessaires pour monter les 15 tonnes de matériaux. Une journée entière d’héliportage rendait notre entreprise difficile à cacher, tout le pays était au courant, et les rumeurs démarraient très vivement à propos de ces fous qui entreprenaient de reconstruire un chalet abandonné et détruit, dans un endroit inaccessible. 
Le travail terminé, nous ne pûmes résister à la tentation de demander au pilote de nous faire faire un petit tour. C’était tout de même trop rageant d’avoir côtoyé un hélicoptère toute la journée sans avoir pu en profiter un peu. De plus les jeunes qui nous faisait l’amitié de se mettre à notre service méritaient bien, par avance, d’avoir cette expérience là.
La ballade dépassa nos espérances. La sensation de s’élever dans l’air, de voir tout ce pays que je connaissais si bien et dont chaque mètre m’avait demandé sa part de sueur, de s’approcher si vite des aiguilles d’Arves, d’arriver entre la tête de chat et l’aiguille centrale, ayant fait en 5 minutes ce qui nous avait demandé une journée entière il y a quelques années, faire le tour de la » tête de chat « , passer au ras de la crête pour redescendre comme en chute libre au dessus de la basse de Gerbier, tout cela était d’une intensité rare. Et pour finir, le pilote nous fit démonstration de ses compétences acquise en formation de combat, nous redescendîmes de la Basse de Gerbier jusqu’à notre point de départ, en rase motte en suivant les méandre du fond d’un petit ravin. Inoubliable.
Mais la journée n’était pas finie pour autant, il nous fallait regagner Entraigues avec la Land Rover, puis monter à pieds à Chanin, un comble.
La montée fut relativement dure. Nous étions fatigués, encore très lourdement chargés, et le temps ne faisait que se dégrader depuis midi. Il faisait de plus en plus frais le vent se levait et il se mit à pleuvoir. Les retrouvailles à Chanin furent dans la bonne humeur, mais il commençait à faire si mauvais que nous nous empressâmes d’entrer dans ce qui restait du chalet pour nous abriter.
Nous étions épuisés, Marc avait heureusement déjà monté une tente de patrouille plus bas, mais il restait encore à mettre à l’abris tout ce qui pouvait craindre la pluie, et à faire notre dîner. Ce dîner fait de saucisses et de purée, pris en gelant dans les courants d’air humides des ruines du chalet restera sans doute longtemps dans nos mémoires. Nous étions épuisés, gelés, et commencions à douter de notre entreprise, nous étions maintenant coupés du monde, livrés à nous-mêmes, c’était un projet trop ambitieux, et les éléments étaient trop forts.
La nuit sous tente nous offrit un certain repos, mais le lendemain, le temps ne s’était pas vraiment amélioré. En un sens, nous nous rendîmes compte de la chance que nous avions eu qu’il fasse beau la veille, car le mauvais temps serait venu une journée plus tôt, le transport par hélicoptère n’aurait pu se faire, nous imposant un retard indéterminé qui aurait pu compromettre sérieusement la réussite de nos travaux dans le peu de temps dont nous disposions.
8b. Le démontage
Nous nous équipâmes de cirés et nous nous mîmes courageusement au travail. Il fallait d’abord monter notre tente de QG avec le poêle que nous désirions maintenant ardemment pour récupérer quelque chaleur. Nous mîmes à l’intérieur la table récupérée de Chanin, les quatre malles disposées contre les murs pour servir de banquette, suivant notre habitude scoute, et le poêle monté à la porte. Cela nous donnait déjà une impression de chez nous, et un confort certes rudimentaire, mais qui nous sembla alors bien précieux. 
Cela fait, nous nous armâmes de pieds-de-biche et d’arrache-clous, et nous commençâmes à démonter le chalet: d’abord les tôles du toit, puis les liteaux, puis les chevrons. Tout bois retiré était rangé bien précieusement en ordre, et numéroté quand c’était nécessaire de façon à savoir où nous l’avions pris de façon à pouvoir le remettre en place ensuite, ou à prendre ses mesures pour le reproduire à l’identique. Des tonnes d’un mélange de terre, de foin et de bois pourris fut retiré de l’intérieur, tout objet récupérable ou vestige mis précieusement de côté, et le reste transporté dans une grande poubelle en plastique pour être déversé au bas du talus. Nous avons même acheté un fort balais de cantonnier pour nettoyer le superbe dallage en grosses pierres. Mais ce travail commençait avec des pelles, et nous creusions les débris et la terre jusqu’à trouver le dallage. Nous avons commencé par le fond de l’étable, puis quand nous sommes arrivé au niveau de la pièce d’habitation, nous avons continué de la même façon les travaux de déblaiement. Nous avons eu alors la surprise de trouver également un vestige de dallage sur la moitié ouest, alors que nos souvenirs de l’époque nous laissait plutôt supposer qu’il n’y avait que de la terre battue. Pour plus de sûreté, nous avons demandé à l’ancien propriétaire ce qu’il en était. Il nous a assuré n’avoir jamais vu de dallage dans la cuisine. En fait, c’est son père et son grand-père qui l’avaient fait, mais l’accumulation de boue ramenée sous les pieds avait progressivement recouvert ce dallage et il a été oublié.
Le tonneau a dû être également nettoyé, il était en particulier souillé par une horrible carcasse de marmotte en décomposition au fond. Sans doute cette pauvre bête avait du tomber dedans et n’avait pu remonter. Franck s’est courageusement dévoué pour dégager tout cela et nettoyer le tonneau. Nous pensions qu’il était complètement pourri, et qu’il ne gardait plus l’eau. Mais en fait il était en chêne fort épais et il s’est révélé en bon état.et tout à fait étanche. Il n’était vide que parce que la goutière du toit avait été enlevée, le privant de sa source. Nous avions donc acheté et monté un fût de 600 litres en remplacement pour rien, mais il était plus prudent d’en monter un en profitant de l’hélicoptère, parce qu’il n’aurait pas été commode de devoir en monter un sur le dos. 
Tout une semaine se passa ainsi dans le gris, travaillant du matin au soir enlevant planche par planche tout ce qui avait constitué le chalet de Chanin. Au fur et à mesure du démontage, chaque élément de la charpente était marqué au feutre et sa place était reportée sur un plan, avec une estimation de leur état de conservation, puis l’élément est soigneusement mis de côté. Même les débris devaient être notés et conservés, afin de pouvoir reconstituer plus facilement à l’identique l’élément endommagé. En particulier la cave devait être remontée intégralement dans l’état, avec sa toiture en tôles, à défaut de la couvrir en lauzes ce qui est toujours notre projet. Un plan particulièrement détaillé de la cave est donc dressé, et chaque tôle est numérotée et l’ensemble est soigneusement mis à part.
Le 6 juillet après midi, notre moral fut fortement éprouvé. Le démontage prenait du temps, les bois étaient dans un bien plus mauvais état que nous le pensions, il ne restait de notre rêve qu’une espèce d’emplacement informe couvert de terre et de pierres tombées, des tas de bois difformes un peu partout autour, et la neige se mit à tomber dans une atmosphère sombre et pesante.
8c. La reconception d’un chalet disparu
Nous passâmes le lendemain presque une journée à mettre de l’ordre, à nettoyer la fouille du chalet, jusqu’à rendre propre comme un carrelage de salle d’opération le dallage que nous avions découvert en dessous des décombres. Cela nous fit du bien. Nous entreprîmes aussi à piqueter et de tendre des cordeaux pour marquer l’emplacement de la structure en bois à reconstruire, ce qui n’était pas si simple, faute de repères bien précis.
Une première surprise nous attendait. Le chalet n’était pas parallélépipèdique, les restes de murs extérieurs semblaient nous indiquer qu’il était plus large devant que derrière. L’étude des 5 fermes de charpente que nous avions soigneusement gardées nous confirmèrent cela.
La seconde surprise était bien plus considérable. Nous savions que le plancher de la grange arrivait à peu près de plein pied en amont du chalet. En regardant bien de près les pierres qui se trouvaient aux deux angles amont du chalet, nous pûmes déterminer à peu près à quel niveau devait être posés les extrémités des deux poutres sablières, ce devait être en fait 20 ou 30 cm plus haut que le sol. L’avenir nous donnera raison. Nous prîmes alors notre beau niveau de maçon tout neuf: un long tuyau en plastique transparent muni à chaque extrémité d’un réservoir, nous remplîmes le tout d’eau, comme il convient, et le principe des vases communiquants devait nous dire à quelle hauteur devaient arriver ces grandes poutres » sablières « , c’est à dire longitudinales. Ainsi nous pourrions tirer un cordeau nous indiquant jusqu’à quel niveau il fallait reconstruire les murs. Or, nous avions beau faire et refaire la manipulation, l’horizontale depuis le fond du chalet arrivait devant à plus de 3 mètres 50 du sol! Cela ne correspondait à rien, ni à l’habitude des chalets d’alpage qui n’étaient pas construits comme des châteaux avec une telle hauteur sous plafond, ni au souvenir que nous en avions que nous pouvions juste passer sous les poutres dans la cuisine, ni aux restes des murs qui ne laissaient pas supposer qu’ils aient pu monter aussi haut.
Nous dûmes donc nous résoudre à penser que le chalet lui-même avait été construit en pente: les poutres sablières, le plancher de la grange et tout le toit faisant un angle de plus de 10% par rapport à l’horizontale! Cela semblait incroyable, aucun d’entre nous n’avait vu une maison construite ainsi. Nous nous demandions s’il était possible que le plancher de la grange soit en pente, comment le toit ferait pour ne pas glisser sur les murs, et si cela ne devait pas donner un aspect pour le moins curieux au chalet.
Lors d’une excursion de courses à Saint Jean de Maurienne, nous en profitâmes pour aller poser la question à l’ancien propriétaire qui nous assura que plancher était parfaitement horizontal. C’était de toute façon impossible, ce n’était pas d’ailleurs la dernière fois que nous le trouvions incapable de répondre à une question simple concernant son chalet, soit qu’il ait oublié, soit qu’il n’ait jamais fait attention.
Or, il y avait une pente, il fallait bien l’admettre. L’analyse des photos anciennes le montraient, mais il est vrai que cela ne sautait pas aux yeux, à cause de l’absence d’horizontale dans le paysage tout en pentes. L’étude des deux portes latérales le confirmèrent, leur hauts étaient coupés en biais. Il restait à savoir de combien il fallait faire la pente en question. Pour cela nous avions que de maigres mais précieux indices.
D’abord, le mur de pierre à l’Est. Tout le pignon manquait, et le haut en avait été en majeure partie tombé, emporté avec le toit. Mais sur une longueur d’environ 1m 50, il semblait offrir une ligne à peu près droite, fait rarissime sur un mur en pierres sèches, on put donc supposer qu’à cet endroit le mur était resté miraculeusement entier. Ensuite notre souvenir que l’on tenait debout dans la cuisine de Chanin, et que nous pouvions même passer sous les poutres, fait rare dans un chalet d’alpage et qui pouvait s’expliquer par la relative grande taille de la famille des anciens propriétaires. Il fallait donc envisager une hauteur de 190 sous les entraits, mais eux-mêmes étant posés sur une sablière de 20 cm, cela faisait une hauteur de murs de 170 au minimum dans la cuisine. Cela correspondait exactement à l’alignement du vestige présumé du sommet de mur, et aussi à la hauteur des deux portes retrouvées, et nous fixâmes arbitrairement nos cordeaux à une hauteur qui devaient être exacts à guère plus de 4 ou 5 cm près.
Une autre question nous intriguait: l’étable ne comportait aucune ouverture, et il nous semblait que cela était un peu bizarre, d’abord à cause de l’obscurité, et aussi parce que 20 vaches, un mulet, des chèvres et des chiens devaient rendre l’atmosphère un peu lourde. Nous sommes allés poser la question à l’ancien propriétaire qui nous assura qu’il n’y avait pas d’ouverture dans l’étable, ce que confirma sa soeur, ajoutant que pour l’obscurité, et bien ils s’éclairaient avec des bougies quand il fallait traire les vaches. Bon, nous avons donc enterré l’affaire jusqu’à ce que l’année suivante, en montrant les photos à un neveu des anciens propriétaires qui y était monté dans sa jeunesse, celui-ci nous fait remarquer que nous avons oublié de faire l’ouverture de l’étable sous la porte de la grange. Il se souvenait bien de cette ouverture, puisque le lieu de pique nique habituel alors est justement la plate-forme ensoleillée et abritée du vent devant la porte de la grange, et qu’il se souvenait avoir laissé tomber son opinel dans cette ouverture et qu’il avait du aller le rechercher au fond de l’étable (dans le purin). Les anciens propriétaires se sont alors souvenu de cette petite ouverture en meurtrière, qu’ils bouchaient avant de redescendre dans la vallée à la fin de l’été.
8d. Débuts de reconstruction
Nous fîmes alors deux chantiers distincts. J’étais responsable de la reconstruction des murs, et Marc devait réfléchir à la conception générale et commencer le travail du bois pour reconstituer la structure du chalet et sa charpente. J’avais les trois jeunes pour aide, ce qui n’était pas de trop, il fallait: fouiller le sol au pied du mur pour retrouver les pierres tombées, aller en chercher d’autres dans les pentes qui soient bien carrées pour compléter, faire provision de petites pierres pour caler les grosses, et aller chercher incessamment de la terre sur l’arête proche de Chanin, sur les terriers de Marmottes pour boucher les trous au centre du mur. Cette terre nous semblait meilleure car elle était purement minérale, contrairement à celle que nous aurions pu prendre contre la maison. La grosse poubelle en plastique était fixée sur la claie, un la remplissait et l’autre ramenait tant bien que mal cette charge instable de plus de 40 kilos jusqu’au pied du mur. Un troisième préparait savamment le mélange avec de l’eau pour en faire une boue pâteuse qui devait remplir les interstices. Cette terre en effet n’a pas fonction de tenir le mur, chaque pierre devant tenir sur d’autres pierres, ou au pire calée par une petite, mais jamais posée sur de la terre qui pourrait partir avec de l’eau de ruissellement en détruisant le mur, mais de le rendre imperméable aux courants d’air, et empêcher que l’eau entre dans le mur et le casse ensuite par le gel.

C’est à ce dur travail qu’Étienne participa, le dénommant du nom de « Cayenne » quand il vint nous voir pour le week-end du 14 juillet. Parti en fait le vendredi 10 après le travail, en voiture, il arriva à une heure du matin au Pont des Tours, il monta de nuit sous une pluie battante pour installer sa petite tente à 3h 1/2 du matin près des nôtres. Le matin, s’amusant de notre surprise il passa la tête par la porte de toile et fit le touriste égaré en disant: « c’est bien ici le camping des mouettes? « . Ce nom est resté au replat dit de « la Reine de Chanin » contre le chemin en contrebas du chalet qui accueillit nos sommeils réparateurs pendant un mois et demi, et contre lequel nous repassons toujours avec une certaine émotion.
Pendant ce temps, la météorologie ne nous était pas devenue plus favorable. Certains jours, il faisait si froid sous la pluie gelée que le poêle fonctionnait en permanence dans la tente de QG et nous devions aller nous réchauffer 10 mn toutes les demi-heures, ce qui n’avançait guère notre travail.
Nous apprîmes aussi à subir les assauts des orages furieux qui s’abattirent contre nous. La première fois, nous fûmes pris par surprise, un vent d’une extrême violence attaqua notre campement quelques secondes avant l’orage proprement dit. La tente de QG menaçant sérieusement d’être emportée, nous nous accrochâmes tous à la mâture et nous avons dû lutter ainsi pendant de longues minutes pour essayer de la maintenir en place malgré les éléments. Nous avions tant de mal que nous n’eûmes mêmes pas la disponibilité d’esprit d’avoir peur de la foudre qui tombait avec une violence formidable tout autour de nous dans la montagne, le tonnerre répercuté à l’infini dans les parois des ravins qui s’éboulaient dans des bruits d’apocalypse. 
Ce premier orage passé nous profitâmes quelques instants du calme admirable qui suivait et nous nous pénétrâmes de la joie d’un arc en ciel d’une beauté et d’une netteté surprenantes, puis nous entreprîmes de consolider notre QG en y attachant tout autour des chevrons et des grosses pierres à chaque angle. Avec l’habitude, nous voyions venir ces orages, depuis l’Etendart, ils allaient vers la Toussuire, restaient quelques instants au dessus du mont Charvin, puis venaient vers nous. Ils passaient ensuite vers les Aiguilles d’Arves, pour tourner dans le fond et revenir sur nous en une deuxième attaque avant de repartir vers le nord. Nous avions alors le temps de vérifier le haubanage de notre QG, de rajouter une bâche au dessus pour améliorer l’étanchéité qui n’était pas suffisante pour de telles pluies, et d’être prêts à le maintenir si le vent devenait excessif.
Cependant, le travail sur les murs prenait un temps infini. Il est vrai que le temps continuellement mauvais ne nous aidait pas, mais monter un mur avec un choix limité de pierres impossible à tailler, et sans l’aide d’aucun ciment demande de tourner et de retourner des dizaines de pierres avant de trouver celle qui convient et comment la mettre pour qu’elle soit bien calée. Certes, nous manquions d’expérience, et surtout nous ne connaissions pas la règle qu’il faut non pas chercher une pierre pour un emplacement donné, mais prendre une pierre quelconque en main et ne pas la reposer à terre avant d’avoir trouvé quelque part dans le mur un endroit pour la mettre. Et puis le travail était de plus en plus difficile à mesure que le niveau du mur montait, parce que les pierres du mur étaient tombées au pied, mais au début, on choisissait automatiquement les plus belles, les plus carrées, et il ne restait donc à la fin que des pierres difformes ou rondes extrêmement difficile à caser ( » des têtes de chats « ). Il fallut alors redoubler d’énergie pour aller en chercher d’autres. Nous aurions certes pu prendre celles de la cabane du cochon peu au dessus du chalet, mais nous ne voulions pas trop démonter cette petite ruine que nous pourrions avoir envie de refaire un jour. Nous sommes allés chercher quelques pierres dans les ruines de chalet encore plus haut, mais la descente chargé était périlleuse pour les chevilles. Nous allâmes dons principalement en direction de la source. Marc en particulier excellait dans cet art, et c’est grâce à lui que quelques pierres presque parfaitement parallélépipèdique de plus de 100 kilos ont pu être rapportées sur la claie (soutenue par quelqu’un d’autre) et ont grandement aidé à faire des pignons de murs bien chaînés.
Voyant que nous ne pourrions jamais remettre les murs tous parfaitement en état nous décidâmes de réparer parfaitement les pignons et les parties avancées des murs, mais de laisser provisoirement une partie de mur effondrée dans le fond du chalet côté est, de ne pas toucher non plus le mur du fond, en talus contre la montagne, ni de toucher à la » bulle » dans le mur entre le chalet et la cave: celui-ci n’étant plus protégé par le toit, l’eau avait pénétré à l’intérieur, et le gel avait progressivement fait que les deux faces du mur s’étaient écartées, le gonflant dangereusement. Or il y avait en face, l’autre mur de la cave, lui adosser sur le roc, et nous pensâmes qu’il suffirait d’étayer par un bois en travers de la cave pour que le processus ne s’aggrave pas.
Une question était difficile à trancher: y avait-il des fondations sous les murs en bois ? Ces murs avaient été arrachés depuis longtemps, labourant le sol quand le vent avait tout emporté, deux tonnes de vieux foin transformé par le temps en humus avait recouvert le tout, et finalement les chasseur avaient aménagé une cabane à cet endroit. Les recherches archéologiques ne nous ont apporté aucun renseignement, et sur les photos d’époque il y avait de l’herbe trop haute pour voir le bas des murs en bois. Finalement il a été décidé de faire ce qui se fait en général ailleurs : de poser la structure de ces murs sur un muret de fondation haut de 30 cm. Le chantier est entrepris, à l’endroit supposé, mais même à l’endroit des angles, ou devait être posées les fortes colonnes de bois supportant la charpente, on ne trouvait que de la bonne terre, dans laquelle on aurait aimer cultiver des salades, mais bien inquiétante comme fondation. (L’avenir montrera que cette absence de fondation profonde est une cause déjà ancienne de la fragilité du pignon du mur est. Il était déjà démoli en 1976, et nous devrons le refaire encore en 2004)
La reconstruction des murs avançant bien, nous avons envisagé en parallèle de travailler à la restauration de la charpente. Après un examen attentif de l’état des poutres anciennes et de celles que nous avions montées en échange, il apparaît que la chose sera possible, mais quand même un point demeure tout à fait inquiétant : les deux pannes sablières qui sont restées en partie posée à même la terre depuis que la toiture s’était envolée (donc depuis près de 10 ans) sont en partiellement attaquée par d’énormes et horribles vers blancs. Sinon elles sont assez solides sur une bonne partie de leur longueur et nous avons de quoi en remplacer 7 m sur les 14 m de chacune. Il fallait donc absolument exterminer ces bestioles. On descend pour demander conseil à notre quincaillier, et il nous propose contre les « voraces » un produit qui a à peu près le prix du Château d’Yquem. Providentiellement, Étienne nous annonce sa visite au même moment et nous nous rappelons qu’Anne Catherine a traité récemment son parquet avec du produit anti-bêtes et qu’il lui en reste un bidon de 20 litres. 2 jours après, Étienne nous apporte ce précieux liquide que nous avons monté sur la claie et dont nous avons copieusement badigeonné les poutres et les chevrons attaqués.
Le temps progressivement s’améliorait et il arriva un jour vers le 18 ou 20 juillet que les murs furent prêts à recevoir les poutres et la structure qu’ils devaient supporter. Or pendant ce temps là; Marc avait bien travaillé, les cinq fermes et les 3 pannes de la charpente avaient été reconstituées, neuves au 2/3 ou 3/4, ainsi que la structure des murs en bois. Cela était possible parce que, bien que souvent pourris et inutilisables, les arbalétriers étaient néanmoins mesurables pour les reproduire à l’identique. Il put ainsi se rendre compte qu’aucune de ces fermes n’était semblable, la plus petite étant la première à partir de l’amont, elles croissaient progressivement vers l’aval jusqu’à la quatrième pour réduire un peu au niveau de la 5ème. Mais nous n’étions plus à ça près, et nous avions décidé de reconstituer exactement Chanin comme il était et nous ne nous posâmes donc pas plus de questions.
Après la triste semaine de démolition, de bilan et de déblayage, puis les 2 semaines du lent travail de fourmis sur les murs et les éléments de charpente, enfin, nous avions l’impression que notre travail portait ses fruits. Après une journée de travail à monter un mur en pierres sèches, on a l’impression que l’on a fort peu avancé, mais déjà après la première journée de mise en place des éléments de charpentes préparés à l’avance, le chalet commençait à ressembler à un chalet. D’ailleurs, dans les hameaux de Saint Jean d’Arves, et dans ceux d’Albiez, les dizaines de paires de jumelles qui surveillaient avec un peu d’ironie les travaux de ces jeunes parisiens ne s’y sont pas trompés. Le chalet qui avait disparu à leurs yeux reparaissait de nouveau, dans un temps raisonnable, et un certain respect s’est alors fait sentir dans nos contacts avec les « gens du pays « .
Mais une angoisse nous vint en repensant aux chevrons que nous avions démonté et qui nous semblaient fort pourris et souvent impossible à réutiliser. Nous en avions des neufs, certes, mais nous avions peur qu’ils soient en quantité insuffisante. Nous nous voulûmes alors utiliser les ressources de nos terres. Dans le lot de Chanin, il y a en effet une parcelle qui est boisée d’épicéas, dans l’extrême limite du bas de la langue de Coirnavan. Marc partit en éclaireur avec un jeune pour aller voir s’il pouvait s’y trouver des sapins qui pourraient être utilisés.
Cette reconnaissance donna le signalement de deux sapins abattus de petit diamètre tout près du chemin de Chanin, dans le Motey. Ce n’était pas chez nous, mais il ne manqueraient à personne là haut, et personne ne viendrait nous les réclamer.
Nous nous offrîmes alors une journée de vacances, avec pour objectif d’aller voir les chalets du Vallon, nos plus proches voisin, afin d’étudier certains détails de construction qui nous manquaient, puis de prendre les deux troncs que Marc avait déjà préparés et ébranchés. Cela faisait tout de même une promenade de 800m de dénivelée, mais nous avions une telle habitude de l’altitude que faire ce chemin, sans les 30 kilos de sacs habituels nous parut une toute petite promenade. Par contre, remonter les troncs qui n’étaient en fin de compte pas très secs, et donc fort lourds fut une épreuve dont nos muscles et nos épaules meurtries se souviennent encore.
Arrivés en haut, sans le dire, nous nous rendîmes compte que ces bois n’étaient pas vraiment utilisables, trop coniques, trop de branches, pas assez secs, ils ne représentaient pas une solution.
Pour ce qui est des chevrons nous fûmes vraiment inquiets Sur les 36 chevrons nécessaires, nous en avions juste la moitié de neufs, grâce à la prévoyance de Marc, il y en avait peut-être une petite dizaine des anciens récupérables en les tournant d’un quart de tout pour éviter le trou pourri de l’ancien clou, mais les autres étaient vraiment mauvais, ou avaient déjà été retournés lors d’une précédente reconstruction.
Nous pensâmes alors sérieusement à ce moment à raccourcir le chalet pour retirer la dernière partie aval qui avait été rajoutée au début du siècle. Cela certes nous fendait le coeur, non pour des raisons d’authenticité, car le chalet l’aurait été pratiquement plus ainsi, mais parce qu’il se distanciait alors de nos souvenirs.
Nous prîmes alors le risque de décider de garder le chalet dans sa grande longueur, et d’intercaler les chevrons neufs avec les anciens, de façon à ce que la force des uns supplée éventuellement à la faiblesse des autres. Le sort nous favorisa encore dans le fait que en mettant à l’amont du toit qui était plus petit certains grands nous pouvions couper la partie abîmée, et ainsi nous n’eûmes pas à utiliser de bois qui nous sembla incapable de jouer correctement son rôle.
Un dilemme se posa néanmoins à nous pour la réalisation de ces fermes. Pour remplacer les arbalétriers pourris, Marc ne disposait que de poutres de 18×18 alors que les originales faisaient plutôt 15×15. Utiliser tels quels ces gros bois aurait été du plus fâcheux effet. Aussi, ne doutant pas de son habileté, je lui demandai s’il n’était pas possible, avec la tronçonneuse de retirer une couche de bois de 3cm sur deux des côtés… Et bien il parvint à réaliser ce chef d’oeuvre de précision. Mais notre goût de la perfection ne nous laissèrent pas en repos pour autant: les bois neufs étaient de section carrée, alors que les anciens étaient plutôt ronds. Alors il y eut en permanence quelqu’un avec une plane qui arrondissait les angles des chacune des poutres. Le résultat fut, ma foi, très satisfaisant.
8e. La charpente
Tous les bois furent ainsi préparés à l’avance, afin qu’il ne reste plus qu’à les mettre en place. Les fermes avaient été reproduites à l’identique. Les poutres longitudinales dites: « sablières » avaient aussi de grandes parties pourries dans les endroits où elles avaient reposé sur le sol. Les bouts récupérables furent gardés, et les autres replacés par des neufs. Marc fit alors un assemblage en sifflet tronqué du plus bel effet, mais il restait encore à maintenir ces assemblages par des clous de charpentiers de 25 cm de long.
Pour quelqu’un qui n’en a pas l’expérience, enfoncer un grand clou de charpentier dans du bois assez dur est l’acte le plus désespérant qui soit: immanquablement celui-ci finit par se tordre, et même en le redressant, il devient alors presque sans espoir d’arriver à ses fins. Mais avec de nombreux coups pour rien et beaucoup de clous tordus, je finis enfin par être le spécialiste des grands clous. L’expérience m’avait appris plusieurs choses. D’abord que le nombre de coups de marteau que peut supporter un clou, quelle que soit leur force, et limité. Probablement que chaque coup ébranle la structure métallique et l’échauffe. Donc, après un certain nombre de coups, le clou a naturellement tendance à être plus fragile. La conclusion est qu’il faut prendre un très gros marteau (nous avions un gros marteau Stanley de 2,5kg) et taper très fort (le plus juste possible, bien entendu), donner des tas de petits coups et se condamner à l’échec. La deuxième chose essentielle que l’observation m’avait apprise, c’est que le coup d’avant de se tordre, la tête du clou se penche dans le sens où le clou se tordra juste après. Il faut donc veiller à ce que la tête du clou reste ou redevienne le plus vite possible perpendiculaire à la pointe. Ce qui nous a fait plaisir, c’est qu’un ami que nous avons rencontré un peu plus tard, et qui lui aussi travaille à reconstruire une maison, nous a dit que lui, n’arrivait toujours pas à planter les pointes de charpentier, et qu’il faisait un avant-trou à la perceuse. Sans la perspicacité de Louis, nous aurions donc été en panne.
Les deux colonnes aux angles avant du chalet furent préparées, avec un tenon mortaise pour recevoir la sablière, et les autres colonnes formant les embrasures des portes furent neuves aussi, recopiées à l’identique, en rétablissant, comme pour les arbalétriers un aspect arrondi grâce à un travail fastidieux de plane. Mais les anciennes étaient pourries à la base, et nous dûmes donc inventer leur longueur en fonction de la hauteur de la sablière et des grosses pierres de base que nous avions préparées pour les recevoir. Grâce aux traces de tenons mortaises sur les anciennes sablières, nous pûmes assez précisément déterminer leur emplacement longitudinal. 
Lorsque tous les assemblages en tenons et mortaises furent prêts, nous installâmes le tout sur les murs, mais ayant toujours peur que la charpente ne descende sur les murs en pente, nous hérissâmes la partie inférieure des sablières de petits clous que nous noyâmes dans une épaisseur de mortier déposée sur le faîte des murs, seul ciment que recèle tout le chalet.
Nous marquâmes alors les emplacements des fermes et des entraits intermédiaires, et nous taillâmes au ciseau à bois des mi-bois de quelques centimètres pour accueillir les poutres transversales.
C’est alors par un beau soleil que nous mîmes avec émotion la première ferme sur le chalet. D’un coup, il semblait que nous avions avancé, et en tout cas à coup sûr notre construction commençait à prendre la forme d’un vrai chalet, et non plus d’une fouille informe. Les quatre autres fermes furent ainsi installées successivement, et la même émotion, le même plaisir s’emparait de nous, nous incitant à fixer ces instants mémorables par de nombreuses photos. Le triangle de chaque ferme était assemblé sur l’herbe, puis déplacée à la force de tous les bras disponibles, mise en place, et maintenue à la verticale par deux planches clouées provisoirement, en attendant mieux.
Cela étant fait, il fallait monter la faîtière sur les croisillons ce qui ne fut pas une mince affaire. En tirant avec des cordes passées dans le sommet des fermes, nous pouvions facilement parvenir juste en dessous, mais faire passer les croisillons était difficile et relativement dangereux, mais cela fut fait.
Nous nous trouvâmes alors devant une certaine difficulté: la faîtière n’était pas d’une seule pièce, mais en trois morceaux. L’espace compris entre les quatre fermes les plus en amont était en deux morceaux, et la dernière tranche qui correspondant à l’allongement du chalet vers l’aval au début du siècle était encore un autre morceau. Or il nous sembla évident que les coupures devaient se trouver porter sur les fermes pour arriver à une certaine solidité. Mais nous avions dû nous tromper quelque peu sur l’emplacement des fermes, et cela ne correspondait pas bien. Nous vîmes alors qu’il suffisait d’avancer la faîtière d’environ 80 cm vers l’aval pour que tout rendre dans l’ordre. Cela supposait qu’on coupe le bout aval qui dépasserait, et qu’on fasse une dernière petite pièce dépassant d’autant de la ferme amont. 
C’est alors que nous comprîmes pourquoi cette faîtière avait miraculeusement échappé au pourrissement. Nous mîmes en effet plus de 20 minutes à couper à la tronçonneuse le bout qui ne dépassait pas les 15 cm de diamètre. Le bois était dur comme de l’acier, elle avait dû être faite dans un bois de sapin de haute altitude aux fibres étonnamment serrées. Sur ce diamètre de 15 cm, nous en comptâmes plus de 80, ce qui est considérable quand on pense qu’en plaine, un sapin de cet âge peut atteindre 60 ou 80 cm de diamètre! La faîtière étant un élément clé de la résistance du chalet, ce n’est certainement pas un hasard si un bois d’une telle qualité avait été choisi. Mais pour l’instant, cela ne nous facilitait pas la tâche, nous n’avions en effet pas envie de redescendre cette grande pièce de bois durement montée en place, et Marc du faire de périlleux exercices de voltige pour réaliser son assemblage à coup de tronçonneuse qui parvenait plus à faire chauffer sa lame qu’à couper efficacement le bois. Mais il le fut enfin, et un grand clou maintint la faîtière sur chaque ferme, prête à recevoir tout le reste du toit.
C’est au cours de ce travail, que le 24 juillet en fin d’après midi nous eûmes la surprise de voir monter 4 types curieux chargés de lourds sacs et coiffés de chapeaux » panama » qu’ils lançaient en l’air: c’étaient les routiers de l’Oratoire qui nous faisaient une visite. Pendant les deux jours où ils furent présents, notre chantier ne manqua pas d’ambiance! Comme il fallait les occuper, nous les chargeâmes d’installer le plancher de la grange. C’était un élément de sécurité, limitant une éventuelle chute du toit à la seule hauteur de la grange. Au dessus de la cuisine, nous avions prévu, comme c’était habituellement le cas, un planché bouveté, pour éviter que le foin ou quelque courant d’air passe entre les planches, et de simples planches pour tout le reste. Le travail n’était pas trop technique et ils s’en sortirent bien, avec seulement de l’aide pour les bords où il fallait faire des découpes subtiles, et parfois un coup de tronçonneuse pour mettre toutes les planches à la longueur voulue. 
Cependant, l’ossature de la charpente se trouva prête à recevoir les chevrons. Une inspection en détail des anciens, en faisant attention à leur état, et à leur longueur nous permit d’envisager pour chacun la place qui pouvait lui revenir et nous pûmes ainsi fixer tous les chevrons de deux gros clous, un en haut dans la faîtière, et un en bas dans la sablière, avec l’aide de notre père et de » l’instit » Michel Grange qui étaient montés pour la journée nous voir. Marc les coupa ensuite à la bonne longueur.
Vint alors un autre problème que nous avions laissé en suspens, et qui nous prit plus de temps et d’énergie que nous le pensions. Les fermes devaient en effet être maintenues par des « contrevents « : pièces de bois mises en biais, partant du haut d’un arbalétrier pour arriver sur la sablière, afin de trianguler la charpente. Or, ne nous pûmes n’en sauver qu’à peine trois ou quatre, et nous n’avions aucun bois du diamètre voulu pour en faire autant en plus, comme il le fallait au minimum.
Mon idée fut la suivante: aux jumelles nous pouvions voir que dans le haut de la forêt qui domine Val-Froide dans le Révi, il y avait nombre de sapins abattus par des tempêtes qui peut-être pourraient nous fournir du bon bois et qui auraient en plus l’avantage d’être les plus près du chalet que l’on puisse envisager puisque la forêt culmine là à 1900m d’altitude.
Je partis ainsi avec Alexandre pendant que les autres partaient faire des courses à Saint Jean et devaient être nombreux pour remonter du matériel dont nous avions besoin. Nous descendîmes le long du Rechet et dans des pentes très abruptes nous pûmes effectivement trouver quatre bonnes perches qui correspondaient à ce que nous cherchions. La remontée fut atroce. Plus de 300m de dénivelée avec une progression difficile et un équilibre sans cesse précaire dans une pente extrême de plus de 45 degrés, et un tronc de plus de 4 mètres sur chaque épaule forçant à s’arrêter en nage tous les dix pas pour les poser verticalement afin de chercher un peu de soulagement. Mais petit à petit, nous parvîmes à notre but, et ils purent immédiatement être utilisés. Le montage des ces contrevents demandait en plus un savant assemblage en biais fait d’autant plus finement que le type de charpente de Chanin à simple sablière laisse très peu de place pour que le contrevent joigne l’arbalétrier à la sablière sans empêcher le passage ultérieur des chevrons. Encore aujourd’hui, la vue de ces contrevents dans le chalet laisse une sensation curieuse mêlé d’une peine indélébile et d’une fierté légitime.
C’est tout cela terminé, et alors que nous commencions à reconstituer la charpente de la cave latérale que vint la date du 27 juillet à laquelle je devais redescendre pour rejoindre Paris, vacances terminées. C’était, comme on le pense bien à regret. Mais ce que nous avions prévu comme tâche à accomplir pour ce premier mois était exactement accompli, et nous avions alors bon espoir d’arriver à boucler les travaux dans l’été. Marc pouvait, lui, rester jusqu’au 15 août, avec l’aide d’une autre équipe qui devait arriver une semaine plus tard. Il y avait certes encore du travail, mais il ne semblait pas qu’il y aurait encore de grandes décisions de conception à prendre. Le principal était fait, et il restait à « habiller » le chalet. Nous n’avions pas tort dans notre analyse, mais nous sous estimions néanmoins le travail qu’il restait à faire, et aussi, ce qui peut être pris pour significatif, le nombre de clous qu’il fallait encore planter. Jusqu’à la fin, il fallut, incessamment monter et remonter des dizaines de kilos de clous, nous ne pouvons dire au juste combien, mais ce qui est certain c’est que nous n’avions pas prévu le dixième de ce qui fut nécessaire!
Nous descendîmes alors tous, mais Marc passa tout au plus une nuit à Albiez, pour remonter dès le lendemain pour une semaine en solitaire.
8f. La cave
Pendant toutes les semaines précédentes, nous avions laissé la question de la cave quelque peu de côté, pensant que si nous étions en retard, nous pouvions toujours la remettre à une autre année. Mais les travaux ayant bien avancé, nous pensâmes qu’ils serait tout de même mieux de la finir avec le reste de la maison, d’autant plus qu’elle protège, par sa pente qui se termine au raz du sol, le côté du chalet le plus exposé aux tempêtes. Cela supposait de refaire en plus petit tout le travail que nous avions effectué ces dernières semaines.
C’est ainsi que Marc dû d’abord reconstruire le pignon du mur qui était tombé. Il le fit en une journée, déplaçant seul des pierres d’une taille insensée, et ce travail qu’il pensait faire à la va-vite fut fait vite, certes, mais largement aussi bien que les autres portions de mur que nous avions refaits. Pour la sablière, il fallut se contenter des restes souvent un peu douteux, mais heureusement, elle ne devait pas supporter une masse importante. Les chevrons, eux, purent rester ceux d’origine, en effet, les tôles étaient restées et ils avaient donc toujours été protégés. Des planches de récupérations firent effet de liteaux, et il ne restait alors plus qu’à mettre les tôles d’origine que nous avions mis à part précieusement.
C’est alors que les choses se corsèrent. En effet, malgré le soin mis à l’ouvrage, la nouvelle cave n’avait pas exactement la même taille que l’ancienne, et il fallut donc retailler toutes les tôles de bord pour les mettre à la bonne dimension. Ce travail fut fort fastidieux, heureusement, Marc n’était pas oublié de la vallée, notre père monta deux fois, une fois avec un ami estivant, et une autre fois avec Hervé Martin dont la force physique et la bonne volonté étaient fort précieuses.
Ensuite, pendant cette semaine, Marc posa les 3 portes de Chanin. Pour les deux portes du bas, celles de la cuisine et celle de l’étable, nous désirions garder les anciennes portes, et il fallait les consolider un peu, et les mettre en place sur les chambranles neuves mises en places. Là encore le quincaillier de Saint Jean de Maurienne, plein de ressources, avait à notre disposition les anciens gonds se terminant par un énorme clou. Fort bien, mais la manoeuvre de mise en place est extrêmement délicate, il s’agit de planter cette énorme clou peu commode sur l’arrête de la poutre constituant le chambranle tout en arrivant à terme à ce que le gond soit en place à quelques millimètres près tant dans sa position que dans l’alignement avec les autres gonds… Pour la porte de la grange, tout était à refaire, l’ancienne ayant été arrachée par le vent. Il ne restait plus qu’à acheter des serrures avec de grosses clés, et de les poser.
Enfin avant d’accueillir l’équipe d’Août, il a fallu reconstituer le stock de nourriture. En effet, les meilleures choses avaient été mangées, en particulier la consommation de confiture avait été très sous estimée, ainsi que celle des boîtes de couscous tout prêt et de semoule pour les salades de midi.
Le lundi 3 août au soir arrivèrent la seconde équipe formée de Sophie Lemarchand (future Mme Louis Pernot), de Philippe Bouillaux, et d’Emmanuel Ranson. Sophie les avait conduits en Land Rover de Paris, et c’est courageusement qu’ils entamèrent la montée de Chanin sous la pluie après une fatigante journée de voyage. L’arrivée dans le noir complet, sous une pluie battante dans la tente qui nous servait de cuisine et de séjour fut heureusement réconfortante, avec la chaleur du poêle, un dîner chaud, et le confort des duvets dans la tente de patrouille Partridge. C’est seulement le lendemain matin que la nouvelle équipe découvre le beau temps, la vue, et le chalet bien avancé.
8g. La couverture
La première chose à faire fut de clouer des liteaux sur les chevrons, et perpendiculaires à ceux-ci, de façon à pouvoir accueillir ensuite les bardeaux. Ce travail n’était pas très difficile, mais il fallait néanmoins souvent interposer des cales à cause du fait que les chevrons n’avaient pas tous le même diamètre. Une frayeur néanmoins, en commandant les liteaux, j’avais simplement multiplié le nombre de liteaux prévus pas la longueur du chalet, plus une marge de sécurité. C’était un calcul un peu trop simple, et nous nous en sommes rendu compte immédiatement. À chaque liteau, il y avait une chute plus ou moins importante, en moyenne de 40 cm, multiplié par des dizaines, et nous risquions d’être à court. Aussi nous dûmes choisir pour chaque morceau de bois la place qui lui convient le mieux afin de limiter ces sinistres chutes perdues. Quand on a pas de tête…
Pendant ce temps là, certains fermaient le bas du chalet en clouant les grosses planches verticales servant de mur extérieur sur les deux façades qui étaient en bois, autour des portes et devant. La jonction entre chaque planche recevait de plus un » couvre joint « , planche plus petite clouée par dessus pour rendre le mur imperméable à l’air. Il fallait par ailleurs percer dans ces murs un trou rond pour le tuyau de poêle. Ce trou fut protégé d’une tôle pour ne pas brûler le bois avec la chaleur. Et il fallait aussi faire deux ouvertures à peu près carrés pour les deux fenêtres. Elles reçurent leur vitre lorsqu’il fut possible d’aller en acheter à Saint Jean de Maurienne à l’occasion d’une course dans la vallée. Là encore, notre désir d’authenticité était héroïque, face à cette vue superbe, seulement deux petits fenestrou de 30 cm de côté furent percées. À l’usage cela est en fait excellent, ces fenêtres sont jolies, elles conservent à la façade son véritable aspect alors que des ouvertures agrandies l’auraient dénaturées, et cela nous invite à sortir pour profiter de la montagne tant par la vue que par nos autres sens.
Et petit à petit, les liteaux recevaient leurs bardeaux. Une première couche fut posée côté est, puis une épaisseur de feutre goudronné pour parfaire l’étanchéité, puis une seconde, plus difficile à mettre parce qu’il fallait la clouer au dessus de l’autre dans les liteaux, alors que ceux-ci n’étaient plus visibles.
C’est à ce moment que notre ami M. vint, avec son fils qui lui était déjà monté une fois pour aider Marc à faire la cave. Le travail avança alors à une vitesse fulgurante. Les deux premières rangées furent clouées en quelques heures sur la face du toit qui est du côté des portes, à l’ouest. Mais en posant plus tard la troisième, qui elle, n’était pas arrêtée par la cave et devait aller jusqu’au bout, Marc se rendit compte qu’il avaient posé les planches les unes à côté des autres, sans se soucier de garder une certaine orthogonalité par rapport à l’axe du chalet. Or sur le toit de Chanin, aucun côté n’est parallèle aux autres, et en continuant ainsi, les bardeaux ne seraient pas arrivés parallèles au bord amont du toit, ce qui aurait été du plus fâcheux effet. Pour réparer cela, à part de tout défaire (ce qui n’était pratiquement pas possible avec ces clous galvanisés qui sont inarrachables sans détruire la planche qu’ils maintiennent), la seule solution était de tailler spécialement des bardeaux de forme un peu en trapèze, permettant de rattraper sur deux ou trois largeur l’angle voulu. Raboter une planche afin que ses deux côtés ne soient plus parallèles n’est pas très difficile, mais il ne faut pas oublier que chaque bardeau doit avoir une rainure à un centimètre des deux bords. Il fallut donc redescendre dans la vallée, acheter une nouvelle provision de clous, toujours en quantité insuffisante, et emprunter le bouvet de notre père pour refaire une rainure sur chacun des bardeaux de rattrapage, une fois mis à la bonne forme. C’était un travail de précision, relativement difficile, il prit un temps considérable, et il a fait très certainement perdre le temps qui avait semblé être gagné. L’aspect du toit en a aussi un peu pâti, avec cet éventail de rattrapage, sans doute invisible par celui qui n’y fait pas attention, mais flagrant pour celui qui le déplore. Cela n’enlève cependant pas l’amitié des rares amis qui ont bien voulu non seulement monter par curiosité, mais aussi donner du temps et de l’énergie pour nous aider dans notre entreprise.
La scierie nous avait livré des bardeaux d’excellente qualité. Ils étaient bien rouges, ni trop secs ni trop humides selon ce qui nous avait été indiqué par le couvreur qui nous a instruit dans la technique du bardeaux. Le cloutage était ainsi aisé, le bois ne se fendant pas sous les clous. Mais la scierie nous avait livré ces planches non pas dans leur longueur d’1m80, ou de 90 cm, mais dans des multiples diverses de ces longueurs, plus une certaine marge. Un des travaux fastidieux consistait donc à trier ces planches, et à les découper à la bonne longueur. C’est Pierre-Emmanuel qui se dévoua pour cette tâche. Il tria l’énorme volume des planches de toutes longueurs mélangées lors des différentes opérations du transport et du stockage, puis les empila finement sur une hauteur d’1 m 50 entre des piquets plantés dans le sol, et les bardeaux furent débités par un ou deux coups de tronçonneuse. Ensuite ces différents bardeaux furent stockés par longueur exacte à 20m du chalet, sur le petit replat de la maison du cochon.
Au cours du travail de couverture, un malencontreux coup de tronçonneuse dans une ancienne poutre rencontre un de ces gros clous forgés qui datent du début du siècle, et la lame de la tronçonneuse devient totalement inutilisable. Or la quantité de bois à couper étant terrible, il n’était pas envisageable de travailler à la scie à main. Il a fallu toute affaire cessante descendre à Saint Jean de Maurienne pour chercher une nouvelle chaîne.
Avant de commencer à clouer une longueur de bardeaux, nous choisissions une des longueurs de bardeaux disponibles en stock, on en descendait une quantité suffisante, puis on cloue un liteau à la bonne longueur. Il faut alors découper et clouer une longueur de feutre goudronné sur la surface inférieure qui sera recouverte, parfois le vent complique un peu cette entreprise. Une équipe de 2 clouteurs s’équipe alors de marteaux et d’une poche pleine de clous galvanisés de la longueur adéquate. Une des échelles est alors attachée par des cordes horizontalement en dessous de la surface à couvrir. Celui qui cloue le bas de la planche, se tient debout sur le mince rebord que constitue cette échelle et cloue à travers 3 épaisseurs de bardeaux dans le liteau, il utilise des clous galvanisés de 7 cm de longueur, tout en surveillant que le bardeau est bien à cheval sur les deux d’en dessous. De manière à rester bien à cheval, il faut donc choisir dans la pile de bardeaux ceux qui sont par hasard un tout petit peu plus larges ou au contraire un peu plus étroits. Parfois le décalage devient à la longue trop grand et on est obligé de couper un bardeau afin de diminuer sa largeur de quelques centimètres puis de refaire la gorge au bouvet pour rattraper la différence. Celui qui cloue en milieu, cloue à travers 2 épaisseurs de bardeaux, dans le liteau, avec des clous galvanisés de 5 cm de longueur. Ce cloutage est a une tâche délicate, d’abord il ne faut pas fendre le bois avec ces clous assez important, et par ailleurs, même avec un cordeau, il n’est pas évident de ne pas sortir du liteau, il faut alors arracher le clou avant qu’il soit trop enfoncé, et refaire une tentative. Il faut aussi un peu de chance pour ne pas tomber sur les clous des épaisseurs inférieures. Une longueur de toit correspond à une centaine de planches à disposer avec ces soins, et il y a 6 longueurs de chaque côté du toit, planter un clou devient alors un réflexe.
Pendant le travail long et fastidieux du clouage, l’habileté de Marc fut encore à contribution. Il fallait en effet fermer la grange au pignon amont, et donc reconstituer un chambranle de porte, et faire de toute pièce la porte, alors qu’il ne restait à peu près rien d’ancien pour copier. Mais le travail sur les photos anciennes put donner une idée des proportions, et des restes divers purent donner deux morceaux de vieux gonds pour la porte qui vinrent s’engager dans deux parties mâles achetées dans la vallée. Et puis Marc voulut aussi faire la cloison intérieure qui devait séparer la cuisine de l’écurie. Il ne restait aussi pratiquement rien de l’ancienne cloison, mais nous nous souvenions qu’il existait une porte de communication dans cette cloison. Dans notre souvenir, cette porte avait été condamnée, mais il nous avait semblé intéressant de rétablir cette communication évitant de sortir dehors pour aller chercher du bois, des provisions ou des outils dans l’écurie. Marc fit ainsi de toute pièce, en un temps record et avec des chutes de bois une chambranle, et une petite porte tout à fait dans le style et parfaitement réussie. L’ancienne propriétaire qui montera quelques années plus tard nous dit qu’en fait cette porte était plus au centre (plus près du lit) que nous ne l’avions pensé…) Quant à la cloison elle même, il n’y a pas grand chose à en signaler sauf qu’il fallait établir une jonction entre le bois et le mur de pierre qui soit la plus ajustée possible afin d’éviter les courants d’air. C’est par un prodige de virtuosité que la tronçonneuse fit une découpe si parfaite du bois qu’on a l’impression que le mur de pierre a été fait après le cloison!
D’une façon à peu près analogue, Philippe Bouillaux ferma la cave en ajustant une porte fort bien faite, tout à fait dans le style. Par la faute de Marc (qui s’est simplifié la vie en mettant les gonds, cette porte s’ouvre dans le sens contraire de l’origine, mais il ne faut pas être trop puriste…)
Et puis, clou après clou, planche après planche, le chalet a fini par trouver toute sa couverture et son habillage de bois sur les deux façades concernées. Cette opération était dangereuse pour le chalet, car elle est somme toute assez longue, et qu’il fallait éviter que le chalet n’offre une trop grande prise au vent en cas de tempête. Aussi nous avons constitué 2 équipes de 2 personnes travaillant en parallèle à la même vitesse sur les 2 pignons. Nous avons été assez tristes quand nous avons fermé le pignon nord, car à cette hauteur, on a vraiment une vue extraordinaire, et les amis de passages nous invitaient tous à mettre une grande baie vitrée afin de garder cette vue. Souvent, nous nous mettions là, face à la vallée pour admirer la montagne et pour surveiller le chemin (pour voir si quelqu’un monte). Mais nous sommes restés incorruptibles afin de laisser à Chanin son aspect et son caractère.
Le pignon nord est constitué de 2 épaisseurs de planches superposées. La première couche a été réalisée en bois neuf, et la seconde en planches de récupération. Pour chaque planche, il y a une découpe à faire, sur mesure pour ajuster au bord du toit et faire le tour des liteaux et des poutres, et couper à la juste longueur en bas. Le sud était à l’origine fait d’une seule épaisseur de planches, mais cela a laissé entrer tant de neige et de pluie dans la grange que le foin pourrissait. Aussi avons nous rapidement posé des couvre-joints comme sur le mur de la cuisine au rez de chaussée. Nous avons par ailleurs cloué des petites planches pour bloquer l’entrée du vent dans la grange sous le toit. Cela est bien sur avantageux pour ceux qui dorment dans le foin de la grange, il ne sont ainsi pas dans le courant d’air, et de plus cela limite un peu le risque d’arrachage de la toiture par une bourrasque. Mais là encore, cette petite entorse à l’origine supprime l’aération naturelle du foin. Le problème est que le foin ramassé n’est jamais tout à fait sec et que la fermentation du foin produit de méthane qui, parait-il, risque de s’enflammer spontanément, et en tout cas gâche le foin ramassé. Aussi avons nous percé, quand même, une petite ouverture en forme de carré de 10 cm de côté sur le pignon nord. Une planchette clouée bouche cette ouverture quand elle n’est pas utile.
Pour le faîte du toit, deux possibilités s’offraient à nous. Traditionnellement, les faîtes des toits de bardeaux étaient (à peu près) étanches par le dépassement des planches du côté ouest (côté des tempêtes) sur le côté est. Nous aurions donc du faire ainsi. Mais nous avons préféré mettre sur le sommet du toit un faîte de tôles. Les deux principales raisons étaient d’abord de garder la silhouette de Chanin telle que nous l’avions connue, et la seconde la crainte que la solution traditionnelle n’offre pas une étanchéité parfaite, et une trop grande prise au vent au cas où une tempête farceuse aurait eu l’idée de souffler de l’est. Et puis l’idée de mêler le bois et la tôle nous semblait esthétiquement une solution assez heureuse. Des clous galvanisés à tête large spécialement prévus pour cet effet servirent alors à fixer ces tôles à leur place. Ce travail n’était pas trop difficile, mais fort pénible parce que la tôle galvanisée n’avait pas tellement envie de se laisser percer par les clous et chaque fois qu’un se tord, on prend un coup de marteau sur les doigts. Mais en fin, après 122 coups sur les doigts la faîtière est en place, et du plus bel effet de solidité, d’étanchéité et d’esthétique.
Il ne resta alors plus qu’à mettre trois grosses serrures aux trois portes de la cuisine, de la cave et de la grange (la porte de l’écurie étant fermée de l’intérieur), et le chalet fut terminé. Avant de partir nous avons démonté la tente de cuisine, mis en place le poêle, la table et les bancs à leur place dans la cuisine de Chanin, puis nous avons de nettoyé, de brûlé les morceaux et les ordures dégradables, rentré tout le bois non pourris à l’intérieur, ainsi que les multiples tentes. 
Le dimanche 16 août à 8 heures du matin par un beau soleil levant éclairant la façade nord, et la pleine lune brillant dans le ciel, toute l’équipe quittait le nouveau Chanin avec une certaine émotion. Certes une grande satisfaction d’avoir accompli un travail considérable les réjouissait, mais le résultat était tellement beau qu’il était difficile de penser qu’on ait pu en être la cause. Tout semblait comme si Chanin était ressorti de ses ruines par une sorte de résurrection miraculeuse dont les causes nous auraient quelque peu dépassées. Il était difficile de croire que le rêve qui nous avait hanté pendant la moitié de notre vie ait pu enfin se réaliser. Or il s’était réalisé, et il n’en était pas moins beau pour autant, au contraire.
Au cours de l’hiver nous sommes montés anxieusement pour voir comment se comportait le chalet après les premières tempêtes d’hiver. Tout allait bien, mais la porte de la cuisine avait subi une tentative d’effraction de la part d’un curieux. Nous avons du détordre la serrure abîmée, puis nous avons pris des mesures un peu plus fortes de protection. D’abord en mettant de simples petits volets accrochés à l’intérieur afin de limiter la concupiscence des gens qui passent. Puis nous avons organisé de fermer le chalet en mettant des poutres derrière les portes de la cuisine et de l’étable. Mais notre principale protection est peut être les bonnes relations que nous avons avec tous ceux qui peuvent fréquenter cette montagne, et d’en laisser l’accès aux équipes de chasseurs qui le demanderaient…
Le travail suivant dans Chanin a été de reconstituer le mobilier. En effet, il ne restait du mobilier d’origine que la table (à restaurer), et deux petits bancs. Sur le modèle des 2 anciens lits qui y étaient à l’origine, nous en avons fabriqué de nouveaux, bien creux, à remplir de foin. Près du lit qui est contre les murs extérieurs, nous avons selon l’habitude locale, tapissé le mur de journaux pour limiter les courants d’airs. Enfin, nous avons construit 1 grand banc et quelques petits bancs, et installé des étagères sur le mur près du poêle. Et enfin, l’année suivante : un buffet pour mettre la vaisselle.
La cave a été terminée l’année suivante, il lui manquait son plafond. À l’origine ce plafond était recouvert d’une épaisse couche de terre qui servait d’isolation. Mais comme nous n’avons pas de beurre ou de tomme à conserver dans cette cave, nous n’avons pas remis de terre.
Un travail considérable a été fait les années suivantes pour améliorer et pour maintenir les chemins. D’abord le chemin habituel a été est élargi à 1 m 50 et débarrassé des racines croche-pieds. Puis le chemin par la ruine de l’Arcosse a été retrouvé avec grand art dans les broussailles malgré 50 ans d’abandon, et a été a peu près dégagé.
Dans les projets, il restait encore à refaire le toit de la cave avec des lauzes, ce qui est un assez gros travail. Nous attendons aussi que les murs en mauvais état que nous n’avons pas refaits en 1992 s’écroulent pour les remonter mais nous avons étayé la charpente en prévision de cela. Nous pourrions également reconstruire la maison des cochons qui 20 m au dessus Chanin. Enfin, nous sommes toujours à tout essayer pour que l’étang artificiel appelé « la gouille » 200 m au dessus de Chanin accepte de garder l’eau de pluie…
Maisa après avoir été réduit pratiquement à l’était de ruine, Chanin pouvait repartir pour une nouvelle vie. Combien de temps pourra-t-il durer? Personne ne le sait. Et s’il a déjà dépassé ses 10 ans, nous savons bien que ce n’est pas seulement grâce à la qualité de notre travail. De toute façon, si un coup de vent le veut vraiment, rien ne peut résister.
Et puis autre miracle de la continuité, nous avons gardé avec les anciens propriétaires de réelles relations amicales, depuis près de 20 ans que nous nous fréquentions. Et une fois le pas franchi de nous céder le chalet, toute méfiance de part et d’autre se sont dissipées. Nous sommes souvent venu les voir pour leur demander conseil, ou nous faire profiter de leurs souvenirs sur la vie à Chanin. En 1993, nous avons pu montrer les photos du chalet reconstruit à la grand-mère qui a été émue de retrouver son chalet comme elle l’avait toujours connu, et c’était très peu de temps avant qu’elle décède. Le fait qu’elle reconnaisse son chalet comme elle l’avait toujours connu était pour nous une vraie consécration et une validation de notre travail. Et puis pour nous, même si nous étions officiellement « propriétaires » de Chanin, il restait toujours un peu le leur, on n’efface pas comme ça des siècles d’histoire. Et nous leur en avons donné la clé. Habitant en face, ils suveillent les allées et venues, et même si le chalet est à vol d’oiseau à trois kilomètres, avec de bonnes jumelles, nous savons ainsi qui et quand y est monté. Ce chalet a en fait créé des liens véritables entre nous, et une très fidèle amitié nous lie avec les anciens propriétaires, et aussi, une grande considération (que j’espère mutuelle), et, il faut le dire, une réelle affection. Cela est un autre miracle de Chanin, et c’est bien précieux, pour nous tout simplement, et aussi parce qu’un chalet a une âme.
8h. La couverture en lauzes
La tempête de décembre 1999 qui a frappé durement la France a frappé également Chanin. D’autres chalets ont été bien plus touchés, certains ont même été complètement démolis par cette tempête.
Monter à Chanin l’hiver n’est pas un petit exercice. En fait il s’agit de monter une pente raide pleine de neige et de glace sur 1000m de dénivellation. Et une fois en haut, les conditions de vie sont relativement rudes. Il faut s’attendre à une température dans le chalet de -10 °, au petit matin il n’est pas facile de sortir de sa montagne de duvets et de couvertures.
Mais vu du Villard (le village qui est en face de Chanin, vers 1550m d’altitude), on remarque avec de fortes jumelles qu’un petit quelque chose de bizarre est apparu sur le toit de la cave. Louis se dévoue pour monter seul voir ce qui se passe là haut. De bon matin, il se lance dans la montée depuis le fond de Vallefroide, franchit un chaos d’arbres arrachés par la tempête, monte (avec angoisse de découvrir une toiture déplacée)… Il y a effectivement des dégats, mais finalement, ce n’est pas trop grave puisque la structure elle même n’a pas été touchée. Une rangée de tôles ont été soulevées sur le toit de la cave. Nous avons vraiment eu de la chance, parce que cette ouverture dans le côté de la toiture le plus exposé aux temprêtes aurait bien facilement pu être la cause de la perte de toute la toiture. C’est ce qui était arrivé déjà une fois à Chanin, et c’est ce qui est arrivé à de nombreux autres chalets. Mais là, heureusement, le vent n’a pas été tout à fait assez fort pour soulever notre lourde toiture en bardeaux de mélèze et son chargement de tout ce qui se trouve dans la grange (foin, réserve de planches, tonneau).
Après avoir pris des photos pour tenter de faire jouer l’assurance, Louis a effectué immédiatement une réparation de fortune en clouant simplement des planches pour maintenir les tôles soulevées sur le trou du toit. Puis est redescendu en vitesse dans la vallée avant la nuit.
Cette aventure nous a décidé à poursuivre la restauration de Chanin en refaisant la couverture de la cave en lauzes, comme c’était le cas à l’origine.
- Ce sera un avantage d’authenticité, et d’esthétique
- Mais également, du point de vue de la résistance aux tempêtes, il n’est pas mauvais d’ajouter 5 tonnes de pierres et de bois du côté le plus exposé aux vents dominants. Peut-être que l’usage des tôles pour les couvertures a précipité la disparition des chalets d’altitude. Ce mode de couverture est plus facile à mettre en oeuvre, moins cher à l’achat, bien moins cher à transporter, vite construit et vite envollé!
Dans le printemps et l’été 2000:
- nous avons pu trouver un fabriquant de lauzes, + commandé 5 tonnes en vrac
- nous avons fait des recherches pour retrouver les techniques de pose traditionnelle dans ce secteur particulier de l’Arvan. Les livres, mais surtout une visite d’un ancien toit de lauzes dans un été de conservation magnifique (ce chalet « Opinel » que nous aimons bien),

- pris les mesures à Chanin des travaux de charpente à réaliser pour la renforcer en vue de recevoir cette charge supplémentaire + commandé le bois.
- nous avons trouvé un hellicoptère qui prenne des charges importantes
- prévu comment disposer à Chanin de perforatrices capable de faire les trous dans les lauzes, et cela sans être raccordé au réseau d’électricité
Suite des travaux de couverture prévue pour l’été 2001…
La suite des aventures se trouve dans la page « Dernières nouvelles » et ses archives…

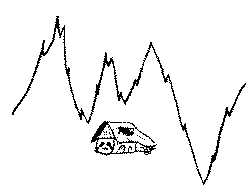










Bonsoir, Après cette très longue histoire, j’espère être invitée pour l’arrosage de cette belle reconstruction. Mais 50 000 F une ruine isolée il fallait vraiment la kiffer grave !!! Bravo.
Je me rends tjrs en montagne en Haute-Savoie lieu où les chalets font legion mais tout y est hors de prix alors je laisse passer mes rêves…
Bonne continuation.
FLEUR13
Bonsoir,
Encore remuée par la énième lecture de votre site, je me décide enfin à vous faire signe .
Mes parents nous ont fait partager, mes cinq frères et soeurs et moi-même, pendant plus de quinze ans, la passion qu’ils avaient pour le Mollard.
Habitant Meudon-Bellevue, nous y venions dès 1960 pour un mois à Pâques . Aristide Rambaud venait nous chercher à l’aube à Saint-Jean de Maurienne et nous logions à la ferme, en face des Aiguilles. Eugène et Pierrot nous apprenaient la montagne .
Je vous écris ce mot depuis l’ancienne épicerie du Mollard où je loge pour un mois, 46 ans après.
Plus encore qu’une méchante bronchite, c’est le souvenir éblouissant de mon enfance montagnarde, très souvent ravivé par vos récits qui m’a poussé à revenir ici .
Merci
Bonsoir
C’est très très sympa comme message.
Vraiment merci !
L’air de la montagne m’a guéri de bien des bronchites causées par la pollution des villes. J’espère que ce bon air vous fera le même effet dès demain ! Ainsi que cette incroyable ambiance qu’il y a en montagne.
Amitiés
Dans la lumière de l’ après-midi, j’ai vu au loin et en face, votre chapelle d’alpage.
Nous avons parlé de vous avec Juliette en buvant le thé.
Amitiés scintillantes